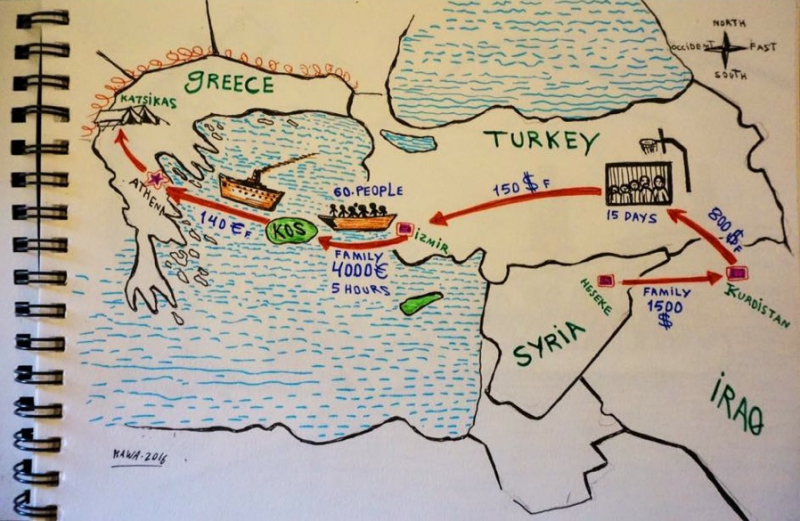Vingt-six ans après Moscou, la folie du premier McDonald’s saisit la Sibérie
lundi 11 juillet 2016 à 21:36Un quart de siècle plus tôt, pouvoir acheter un hamburger-frites emballé dans du papier translucide orné d'un “M” couleur or était un luxe à Moscou. Le 1er janvier 1990, quelque 30.000 Moscovites s'alignaient en une file d'attente mémorable devant le premier McDo de l'Union Soviétique, qui ouvrait sur la prestigieuse Place Pouchkine de la capitale.
Si la plus grande chaîne mondiale de fast-food n'excite plus guère les habitants de la Moscou d'aujourd'hui, McDonald's continue à se frayer de nouvelles voies ailleurs en Russie, et à provoquer des ruées qui rappellent la frénésie de son inoubliable première apparition en URSS. Le mois dernier, c'est à Barnaoul, cité de 600.000 âmes dans le sud de la Sibérie, qu'un restaurant de la chaîne a ouvert pour la première fois ses portes. Une foule, surtout d'adolescents, a patienté devant plusieurs heures à l'avance.
Sur les médias sociaux russes, les internautes ont été nombreux à se demander—mi-amusés, mi-inquiets—si la folie McDonald's à Barnaoul signalait le “retour des années 1990”.
Ну вот и 90е вернулись. Кто хотел повтора – радуйтесь #Барнаул #Макдональдс https://t.co/GoODiPNwrt
— Хомячий Корм (@HomKorm) 1 July 2016
Voilà revenues les années 1990. Ceux qui en voulaient le retour, réjouissez-vous. #Barnaoul #McDonalds
D'autres ont plaisanté que ceux qui se gaussaient de McDonald's et les gens qui ont fait la queue n'étaient que des envieux dépités d'être arrivés trop tard pour être en bonne place dans la file d'attente.
и тут Барнаул разделился на два лагеря: тех, кто острит про Макдональдс в соцсетках и тех, кто стоит в очереди на открытии
— Daria Melnik (@dannimelnik) 1 July 2016
Et alors Barnaoul s'est scindé en deux camps : ceux qui ricanent du McDonald's sur les réseaux sociaux, et ceux dans la file d'attente pour l'ouverture
Vu le statut d'icône du capitalisme américain de McDonald's, des utilisateurs de Twitter se sont délectés d'un peu de politisation, en adaptant le mème “KrymNash” (“La Crimée est à nous”) au débarquement de la chaîne étatsunienne de restauration rapide dans le sud de la Sibérie :
Проклятые пиндосы оккупировали Барнаул и под дулами автоматов, согнали жителей в очередь МакДональдс! БарнаулНаш! https://t.co/4xFRaXD9HT
— Януковича НЕТ! (@KodeksuNET) 1 July 2016
Les maudits Amerloques ont occupé Barnaoul et sous la menace des armes ont rassemblé les habitants en file d'attente devant un McDonald's ! Barnaoul est à nous !
Embourgeoisement à la sauce sibérienne
Les médias ont peiné à expliquer l'apparent engouement de Barnaoul pour McDonald's, qui pour les Russes de Moscou a un goût de réchauffé, puisqu'ils y ont goûté dès 1990. Le site web d'information the Village est même allé interroger des sociologues et des psychologues, qui ont conclu que McDonald's, avec sa séduisante “ambiance occidentale” est en phase avec la culture jeune du pays. A en croire ces spécialistes, McDonald's, dans les provinces russes, bénéficie aujourd'hui du facteur “cool” que des chaînes comme Starbucks ont réussi à exploiter dans les quartiers embourgeoisés de nombreuses villes européennes. (Starbucks, soit dit en passant, n'est pas encore arrivé en Sibérie.)
La jeunesse de Barnaoul a visiblement voulu afficher sa consommation de la nourriture et de la marque McDonald's, en agrémentant ses photos du restaurant sur Instagram de mots-clés de la vie ordinaire tout droit sortis du marketing viral de la firme elle-même, comme (en russe) #été, #ville, #j'adore, #superjournée, #humeurd'été, #bonheur, #selfie, et #sourire.
<script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js">
La journée d'aujourd'hui entre dans l'histoire j'ai essayé le manger du MacDo ! #McDonalds #Arina #été #Barnaoul
Beaucoup de jeunes femmes qui ont dîné au McDonald's de Barnaoul ont partagé des selfies avec des légendes insistant sur le fait que faire attention à la santé et à la beauté ne devait pas exclure un plaisir coupable occasionnel.
<script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js">
Nous partons nous régaler de fast food :) #McDonalds #Fatiguéedurégime #Jeveuxbouffer #Eté #Amour
Comme tous les ados du monde
Les adolescent.e.s russes, et particulièrement ceux et celles de Barnaou, peuvent bien être des retardataires à la table du fast food à l'américaine, les rituels autour du McDo suivis sur les réseaux sociaux sont étonnamment similaires à ceux qui s'observent dans le monde entier. Selon les spécialistes des médias Andrew L. Mendelson et Zizi Papacharissi, les ados de par le monde utilisent les médias pour documenter avec rigueur leurs virées sur les routes, leur fréquentation des chaînes de fast-food, et leur présence aux soirées.
La psychologue Susan Albers indique que l'on ne poste pratiquement jamais des photos d'amis à des endroits comme le McDonald's pour parler de ce qu'on a mangé : il s'agit bien plus de l'ego de l'individu, et de communiquer l'importance sociale de la personne, voire un appel à l'aide (si, par exemple, les habitudes alimentaires décrites sont dangereusement malsaines).
La consommation ostentatoire affichée le mois dernier à Barnaoul rentre dans les schémas décrits par Mendelson, Albers, et autres. Le même comportement aurait peut-être été observable à Moscou en 1990, si des plates-formes comme Instagram avaient existé pour les jeunes partageant un repas entre amis. Ces photos des premiers hamburgers et milkshakes authentiques d'Union Soviétique n'auraient pas manqué d'être un succès viral.