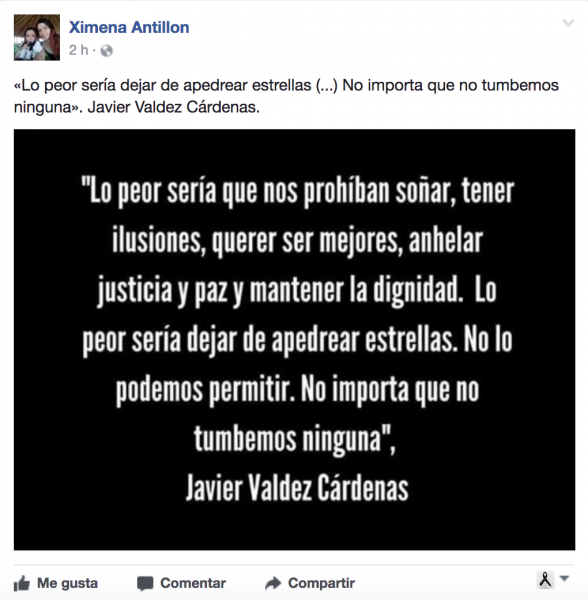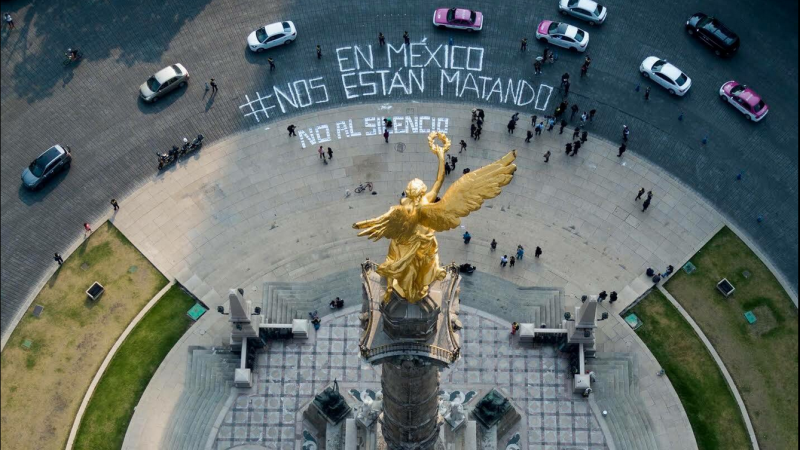Documentaire : Quel a été le rôle des grands médias brésiliens dans l'assassinat d'une adolescente ?
lundi 22 mai 2017 à 20:26
L'image d'Eloá à la fenêtre, en train de pleurer pendant qu'on la séquestrait, reste gravée dans les mémoires collectives du Bésil. Capture d'écran de ‘Qui a tué Eloá?’
Si on pose la question à n'importe quel Brésilien sur “l'affaire Eloá”, il saura certainement de quoi il s'agit. En octobre 2008, le pays entier a été témoin en direct de la séquestration d'Eloá Cristina, âgée de 15 ans, qui a été gardée en otage pendant une semaine et ensuite assassinée par son ex-copain Lindemberg Alves, qui avait alors 22 ans.
Le 13 octobre 2008, Eloá était avec ses camarades de classe en train de faire un travail scolaire dans son petit appartement, à l'intérieur d'une résidence de Santo André, à proximité de São Paulo, quand Lindemberg est entré chez elle de force muni d'une arme. Le jeune n'acceptait pas que la relation avec Eloá soit terminée. Deux de ses amies furent libérées à ce moment mais Nayara, la meilleure amie de Eloá est restée. Elles ont alerté la police puis les médias sont ensuite venu sur les lieux.
Pendant que la police négociait avec Lindemberg, deux chaînes de télévision transmettaient les faits en direct. Un journaliste a même interviewé Eloá et Lindemberg à travers la même ligne téléphonique qu'utilisait la police pour négocier la libération des otages. Eloá a dû répondre à des questions telles que “Tu l'aimes encore ?”, pendant qu'ils analysaient son profil sur les réseaux sociaux. Dans un des programmes de télévision, un prétendu spécialiste a dit qu'il “espérait que cela se finisse bien”, qu'Eloá et Lindemberg résolvent leurs différends et se marient.

La réalisatrice Livia Perez, habituée à traiter ce genre de sujet, s'est centrée sur l'affairee cas afin de parler des violences machistes | Photo: Alf Ribeiro/Utilizé avec son autorisation
Même si Lindemberg a libéré Nayara le premier jour, la police a demandé à la jeune fille de revenir afin de faciliter la négociation avec l'agresseur.
Cinq jours après, le vendredi après-midi, la police est finalement entrée dans l'appartement. On entendit des coups de feu puis on vit Nayara sortir de l'appartement avec une blessure à la tête. Par contre Eloá était inconsciente, elle avait pris une balle dans la tête. Lindemberg s'est battu avec la police dans les escaliers à l'extérieur du bâtiment, sous les yeux de nombreux journalistes et curieux qui étaient aux alentours.
Tout a été transmis en direct à la télévision sous les yeux de millions de téléspectateurs.
L'image d'Eloá en train de pleurer à la fenêtre pendant qu'elle était retenue en otage par son ravisseur, à peine quelques jours avant sa mort, est devenue un symbole emblématique non seulement de la prise d'otage la plus longue de l'histoire du Brésil mais aussi de la pire gestion de prise d'otage et la plus sensationnaliste de l'histoire.
Huit ans après, la cinéaste brésilienne Livia Perez a décidé de faire une chronique sur ce qui est arrivé à Eloá. Mais elle n'a pas souhaité raconter l'histoire à travers d'interviews des proches d'Eloá, au contraire elle a voulu mettre en avant les reporters et la police, afin d'analyser comment les médias et la société idéalisent les histoires de violence contre les femmes.
Son documentaire sorti en 2016 et qui fut récompensé est intitulé “Qui a tué Eloá ?”. Il a été projeté dans les festivals de cinéma du monde entier, d'Uruguay au Mexique en passant par la France, des écoles de Corée du Sud aux prisons du Brésil. Dans un entretien avec Global Voices, Perez parle de sa motivation pour la réalisation de son projet, de la dure réalité de la vie quotidienne des Brésiliennes (Au Brésil, 13 femmes sont tuées chaque jour), et des sujets récurrents des médias lorsqu'ils traitent des cas de violence envers les femmes et les petites filles.
Le documentaire de 24 minutes est disponible avec des sous-titres en anglais et en espagnol :
Global Voices (GV): Qu'est-ce qui vous a motivé à raconter l'histoire de Eloá ?
Livia Perez (LP): O tipo de crime do qual Eloá foi vítima é também o crime que vitima milhares de mulheres brasileiras. A história de Eloá é também a história de muitas brasileiras. O Brasil é o 5º país em que mais se matam mulheres e apesar disso a imprensa não pauta a violência contra a mulher ao noticiar esse tipo de crime. Essa foi minha principal motivação: reconhecermos o crime contra Eloá como feminicídio.
Livia Perez (LP): Le type de crime dont a été victime Eloá affecte des milliers de femmes brésiliennes. L'histoire d'Eloá est l'histoire d'un grand nombre de Brésiliennes. Le Brésil occupe le 5ème rang en nombre de femmes assassinées, et malgré cela, la presse ne parle pas des violences faites aux femmes lorsqu'elle couvre ce genre de crimes. D'où ma motivation principale : faire reconnaître le crime contre Eloá comme un féminicide.
GV: Que fut la chose la plus difficile lors de votre travail sur cette histoire ?
LP: O maior desafio foi não reproduzir os vícios do jornalismo tradicional nas formas estéticas do filme, ou seja, refletir sobre como contar sobre este crime utilizando imagens produzidas pelos meios de comunicação tradicionais mas também os criticando ou propondo outras perspectivas.
LP: Le plus grand défi a été de ne pas reproduire les vices du journalisme traditionnel dans l'esthétique du film, c'est à dire réfléchir à la manière adéquate de raconter ce crime en utilisant les images transmises par les médias traditionnels, tout en les critiquant et en proposant un tout autre point de vue.
GV: Dans le documentaire il n'y a pas d'entretien avec l'amie d'Eloá qui a survécu à la prise d'otage, ni avec la famille, ni même avec l'enquêteur chargé de l'affaire, comme ça se fait normalement dans les documentaires d'affaires criminelles. Pourquoi avez-vous fait ce choix?
LP: Justamente porque o filme não é sobre este caso específico ainda que o utilize como base. É preciso ver o cenário de forma relacional, e não individualizada. Não me interessava utilizar a mesma narrativa da qual lançou mão a imprensa, não me interessava espetacularizar o crime como algo isolado e único. A escolha pela narrativa enfocada na atuação da imprensa permitiu também questionar o posicionamento da polícia e da sociedade perante os feminicídios.
LP: Justement parce que même si le film ne traite pas de ce cas particulier même s'il l'utilise comme base. Il est nécessaire de voir le scénario de façon relationnelle et non individualisée. Cela ne m'intéressait pas d'utiliser le même récit que celui lancé par les médias, je ne cherchais pas à scénariser le crime comme un fait unique et isolé. Le choix d'une narration ciblée sur l'attitude des médias m'a permis également de remettre en cause le point de vue de la police et de la société face aux féminicides.
GV: La transmission en direct de son assassinat et le fait que les chaînes de télévision ont minimisé la situation de l'otage paraît complétement surréaliste, mais quelle partie de tout ça faites-vous ressortir ?
LP: Na minha opinião existem muitas irregularidades a começar pela difusão da notícia de sequestro o que no decorrer dos dias só fez com que o sequestrador se sentisse mais poderoso. Entre os absurdos do repórter que se diz ‘amigo da família’ e do advogado que torce para que ‘tudo termine em pizza e num casamento’ entre vítima e sequestrador acho que o fato da imprensa poder falar com o sequestrador pelo telefone é o mais problemático pois ela acaba por mediar uma situação de risco para a qual não tem competência. Também é muito nociva para a construção da narrativa romântica do crime e o enaltecimento da personalidade do criminoso que a mídia faz para tentar ganhar/manter a audiência.
LP: A mon avis, il y a eu de nombreuses irrégularités, à commencer par la diffusion en direct de la séquestration, qui au fur et à mesure que les jours passaient, ont donné de la puissance au preneur d'otage. Parmi toutes les absurdités, comme par exemple le journaliste qui a prétendu être un ami de la famille et l'avocat qui espérait que “tout finirait bien, avec un mariage en prime” entre la victime et le ravisseur, je crois que le plus problématique a été le fait que les médias ont réussi à communiquer par téléphone avec le ravisseur, et finirent en médiateurs dans une situation à haut risque pour laquelle ils n'étaient pas qualifiés. La construction d'un narratif romantique autour du crime et la glorification de la personnalité criminelle du ravisseur qu'ont créée les médias pour capter et maintenir l'audience ont également été nocives.
GV: Le documentaire questionne le narratif de “l'homme non conforme” et du “crime passionnel”, très utilisé par le journalisme pour justifier les féminicides. Cela a-t-il changé à ce niveau-là depuis 2008?
LP: Quero acreditar que sim, algumas coisas mudaram mas sei que outras nem tanto. Acho que as redes e as fontes de informações alternativas ficaram muito mais viáveis com a internet e levam cada vez mais gente a questionar os meios de comunicação tradicionais e consequentemente a difusão que fazem dos crimes de machismo (feminicídio, estupro, abusos, assédios…)
LP: J'aime penser que c'est le cas, que certaines choses ont changé mais je sais que d'autres restent les mêmes. Les réseaux sociaux et les sources d'informations alternatives sont maintenant très viables grâce à internet et invitent de plus en plus les gens à se poser des questions sur les médias traditionnels, et par conséquent la manière d'informer des crimes sexistes (féminicides, viols, abus sexuels, harcèlement…).

Au moins trois médias ont réussi à interviewer le ravisseur pendant la prise d'otages, en utilisant la même ligne téléphonique que celle que la police utilisait pour négocier avec le ravisseur. Capture d'écran de ‘Qui a tué Eloá ?’
GV: Une enquête récente a révélé que 57% des Brésiliens sont d'accord avec la phrase “un bon délinquant est un délinquant mort”. Néanmoins quand il s'agit de féminicides, beaucoup de gens ont l'air de montrer plus d'empathie envers l'assassin qu'avec la victime. Pourquoi, à votre avis ?
LP: Sou totalmente contra o discurso “bandido bom é bandido morto” e repudio o justiçamento social e o populismo penal. O que acontece nestes crimes que ganham as mídias é que são noticiados de forma machista, ou seja, os autores de feminicídios são mostrados como como dignos de pena, enquanto as verdadeiras vítimas são recriminadas, culpabilizadas e ignoradas. Isso causa uma inversão de valores muito danosa e pior muitas vezes promovidas por empresas e grupos que operam em concessões públicas como é o caso das TVs abertas. Foi assim no sequestro e assassinado de Eloá, no sequestro e assassinato de Eliza Samudio, na repercussão do estupro coletivo de uma adolescente numa favela no Rio de Janeiro…
LP: Je suis totalement contre l'idée “qu'un bon délinquant est un délinquant mort” et je refuse que la société se fasse justice elle-même, de même que le populisme pénal. Ce qui se passe avec ces crimes, c'est qu'ils sont racontés de manière machiste, sexiste, c'est à dire que les auteurs de ces féminicides sont décrits comme des personnes dignes de pitié pendant que les véritables victimes sont ignorées, culpabilisées et vilipendées, ce qui génère un renversement des valeurs extrêmement nocif, et le pire c'est que ce renversement de valeurs est souvent promu par des entreprises et des groupes d'entreprises publiques, comme c'est le cas avec les chaînes de télévisions ouvertes. C'est ce qui s'est passé pendant la prise d'otage et l'assassinat d'Eloá, celui d'Eliza Samudio, ou encore lors de la couverture médiatique du viol d'une adolescente par un gang d'une favela de Rio de Janeiro…
GV: Depuis 2015, le féminicide est un terme légal dans le code pénal du Brésil. Par conséquent, c'est un délit dans notre législation, mais malgré cela le Brésil est toujours le cinquième pays pour le nombre de femmes assassinées. D'où vient le problème d'après vous ?
LP: Acho que falta um esforço coletivo para combatermos essa alta taxa de feminicídio. A meu ver o começo poderia ser pela reforma da mídia ou então pelo cumprimento do artigo 8.º, inciso III, da Lei Maria da Penha que prevê a responsabilidade dos meios de comunicação para a erradicação e prevenção da violência doméstica e familiar.
LP: Je pense qu'il manque un effort collectif afin de combattre l'important taux de féminicides. A mon avis cela devrait commencer par une réforme dans les grands médias du pays et par l'application de l'article 8, paragraphe III, de la Loi Maria da Penha, qui prévoit la responsabilité des médias de communication dans l'éradication de la violence domestique et familiale.
GV: Durant l'année dernière, l'Amérique Latine (une des régions au plus fort taux de féminicides de la planète) s'est mobilisée pour protester contre la violence machiste avec des campagnes telles que #PasUneDePlus. De quelle manière le percevez-vous ?
LP: São levantes fundamentais e esperançosos numa América Latina que ainda é muito machista. Agora acho que precisamos integrar o feminismo às pautas políticas e ainda tem uma luta grande por representatividade a ser conquistada.
LP: Ces manifestations sont fondamentales et donnent de l'espoir pour une Amérique Latine qui reste majoritairement machiste. Maintenant je crois que nous devons intégrer le féminisme dans les débats politiques et que nous devons encore lutter fortement pour conquérir une représentativité.