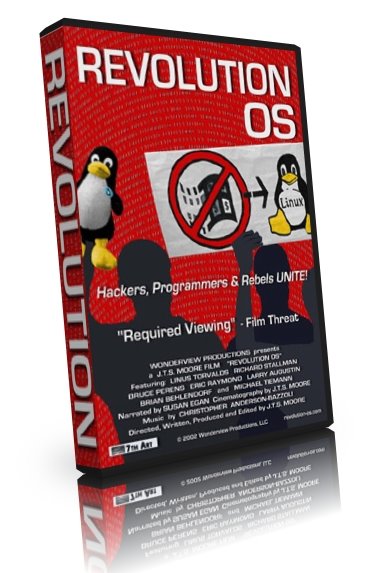Pourquoi j'ai quitté Google
mercredi 20 mars 2013 à 17:48Il y a un an le développeur James Whittaker quittait Google et le faisait savoir dans un article cinglant qui en disait long sur l’évolution de l’entreprise, obnubilée par la publicité et la concurrence de Facebook.
Nous avons choisi de le traduire car les arguments nous semblent malheureusement tout aussi valables aujourd’hui.
Ah, oui, et où est-il allé ensuite ? Réponse ici : Why I joined Microsoft ;)

Pourquoi j’ai quitté Google
James Whittaker - 13 mars 2012 - Blog personnel
(Traduction : ACA, VifArgent, KoS, Eijebong, Alpha, angezanetti, Penguin, audionuma, P3ter, KoS + anonymes)
Ok, je cède. Tout le monde veut savoir pourquoi je suis parti, et répondre individuellement n’est pas forcément évident, voici donc les détails de la version longue. Vous pouvez en lire un bout (je vais à l’essentiel au troisième paragraphe) ou la lire en entier. Mais avant, une remarque préalable : il n’y pas de drame, pas de grand discours, pas de critiques d’anciens collègues et rien de plus que ce que vous pouvez déjà présumer d’après ce qui se dit dans la presse ces jours-ci autour de Google et de son attitude envers la vie privée des utilisateurs et les développeurs. C’est simplement une analyse plus personnelle.
Quitter Google ne fut pas une décision facile. Durant mon séjour là bas je suis devenu passionné par l’entreprise. J’ai fait quatre présentations « Google Developper Day », deux « Google Test Automation Conferences » et j’étais un contributeur prolifique du blog Google test. Des recruteurs m’ont souvent demandé de les aider à embaucher leurs champions. Personne n’avait besoin de me demander deux fois de promouvoir Google et personne ne fut plus surpris que moi quand je fus incapable de continuer à le faire. En fait, les trois derniers mois que j’ai passé à travailler chez Google ont été une énorme déception durant lesquels j’ai essayé en vain de rallumer ma passion.
Le Google qui me passionnait était une société high tech qui poussait ses employés à innover. Le Google que j’ai quitté était une société publicitaire concentrée uniquement sur l’aspect financier.
Techniquement, je suppose que Google à toujours été une entreprise de publicité, mais pendant la majeure partie de ces trois dernières années, ça n’y ressemblait pas. Google était une entreprise de pub uniquement dans le sens où une bonne émission télévisée est une entreprise de pub : avoir un bon contenu attire les publicitaires.
Sous Eric Schmidt, les pubs étaient toujours à l’arrière plan. Google a été lancé comme une usine à innovations, incitant les employés à être entreprenants au travers les prix des fondateurs (NdT : prix accordés aux employés les plus méritants sous forme d’action Google, pour retenir les meilleurs employés à Google), les primes par les pairs et le fameux 20% du temps (NdT : Google permet(tait ?) à ses employés de consacrer 20% de leur temps de travail à des projets personnels). Nos revenus publicitaires nous ont donné de l’aisance pour réfléchir, innover et créer. Les plateformes comme App Engine, Google Labs et l’open source ont servi d’environnements de test pour nos inventions. Le fait que tout ça était payé par une machine à fric complètement bourrée de publicité a échappé à la plupart d’entre nous. Peut-être que les ingénieurs qui travaillent vraiment sur les pubs l’ont senti, mais le reste d’entre nous était convaincu que Google était une entreprise de technologie avant tout et par-dessus tout, une entreprise qui engageait des personnes intelligentes et qui faisait un gros pari sur leur capacité à innover.
De cette machine à innovation sont sortis des produits stratégiquement très importants comme Gmail et Chrome, des produits qui étaient le résultat de l’esprit d’entreprise au plus bas niveau de l’entreprise. Bien sûr, cette innovation emballée crée quelques ratés, et Google n’y a pas échappé, mais l’entreprise a toujours su perdre sans s’entêter et apprendre de ses échecs.
Dans un tel environnement, il n’est pas essentiel d’être au sein de l’exécutif pour réussir. Vous n’avez pas besoin d’être chanceux et d’atterrir sur un projet « sexy » pour construire une grande carrière. N’importe qui ayant des idées ou le niveau pour contribuer, pouvait s’impliquer. J’avais énormément d’opportunités pour quitter Google pendant cette période, mais il était difficile d’imaginer un meilleur endroit pour travailler.
Mais c’était le « bon temps » comme on dit, et ce temps-là n’est plus.
Il se trouve qu’il y a un point où la machine à innover Google a faibli, et ce point est crucial : concurrencer Facebook. Des efforts informels ont produit un duo antisocial avec Wave et Buzz. le réseau social Orkut n’a jamais marché en dehors du Brésil. Comme le dit le proverbe (« le lièvre trop confiant risque une courte sieste »), Google s’est réveillé de son rêve social en voyant son statut d’empereur de la pub menacé.
Google peut bien brandir des publicités à davantage de personnes, Facebook en sait beaucoup plus sur eux. Publicitaires et éditeurs chérissent ce genre d’informations personnelles, tant et si bien qu’ils mettent parfois plus en avant Facebook que leur propre marque. Démonstration n°1 : une entreprise avec la puissance et l’influence de Nike mettant sa propre marque après celle de Facebook ? Aucune entreprise n’a fait ça pour Google et Google en a pris ombrage.
Larry Page a pris lui-même le contrôle pour corriger cette erreur. Le social fut « nationalisé » au sein de l’entreprise, un plan appelé Google+. C’était un nom menaçant qui donnait le sentiment que Google ne suffisait pas. La recherche devait être sociale. Android devait être social. YouTube, jadis heureux de son indépendance, devait l’être… bon, vous avez compris. Encore pire, l’innovation aussi devait être sociale. Les idées qui ne réussissaient pas à mettre Google+ au centre de l’univers étaient une perte de temps.
Tout à coup, 20% signifiait incompétent. Google Labs a fermé. Les prix d’App Engine ont augmenté. Les APIs qui étaient gratuites depuis des années furent dépréciées ou devinrent payantes. Alors que les valeurs entrepreneuriales disparaissaient, un discours moqueur à l’égard de « l’ancien Google » et de ses tentatives ridicules de concurrencer Facebook est apparu pour justifier un « nouveau Google » qui promettrait de faire plus avec moins.
Les jours heureux où Google embauchait des gens intelligents et innovants pour inventer le futur étaient terminés. Le nouveau Google savait au-delà de tout doute à quoi devait ressembler le futur. Les employés n’avaient rien compris et l’intervention des dirigeants allait tout remettre en ordre.
Officiellement, Google a déclaré que « le partage sur le Web était en panne » et rien d’autre que la force cumulée de nos esprits autour de Google+ ne pouvait le réparer. Il y a de quoi admirer une entreprise qui a la volonté de sacrifier des idoles pour rallier ses talents afin de faire face à une menace à l’encontre de ses intérêts. Si Google avait eu raison, l’effort aurait été héroïque et beaucoup d’entre nous voulaient réellement être impliqués dans ce qui serait la solution. Je me suis laissé convaincre. J’ai travaillé sur Google+ comme responsable du développement et j’ai écrit un bout de code. Mais le monde n’a jamais changé ; le partage non plus, n’a pas changé. Dire que nous avons participé paradoxalement ) améliorer Facebook est discutable, mais tout ce dont je disposais n’était en fait que des tests comparatifs à la faveur de Facebook.
Il s’est avéré que le partage n’était pas en panne. Le partage fonctionnait bien et de manière efficace, Google n’en faisait simplement pas partie. Tout le monde autour de nous partageait et semblait plutôt content. Aucun exode des utilisateurs de Facebook ne s’est jamais produit. Je n’aurai même pas pu montrer Google+ une deuxième fois à ma fille, « la vie sociale n’est pas un produit » m’a-t-elle dit après que je lui ai fait une démonstration. « Un réseau social c’est des gens, et les gens sont sur Facebook ». Google était l’enfant-roi qui, après avoir découvert qu’il n’avait pas été invité à la fête, avait organisé la sienne de son côté.
Google+ et moi, ça n’aurait jamais pu marcher. En vérité, je n’ai jamais tellement été intéressé par la publicité. Je ne clique pas sur les pubs. Lorsque Gmail affiche des pubs basées sur les choses que je tape dans mes courriels, cela me fait flipper. Je ne veux pas que mes résultats de recherche contiennent les coups de cœur des abonnés de Google+ (ou de Facebook ou de Twitter). Lorsque je cherche « rue de la soif à Londres », je veux un meilleur résultat que la suggestion sponsorisée « Achetez une rue de la soif de Londres chez Carrefour ».
L’ancien Google a fait fortune avec les publicités parce qu’il proposait du bon contenu. C’était comme à la télévision : faites la meilleure émission et vous aurez le plus de revenus publicitaires des entreprises. Le nouveau Google semble surtout se concentrer sur les entreprises.
Peut être que Google a raison. Peut être que le futur c’est d’en apprendre le plus possible à propos de la vie privée des autres. Peut être que Google est le mieux placé pour savoir quand je devrais appeler ma mère et que ma vie serait meilleure si je fais les soldes chez H&M. Peut être que s’ils me harcèlent en constatant tout ce temps libre dans mon agenda je ferais plus de sport.
Peut être que s’ils affichent une publicité pour un avocat spécialiste du divorce à cause de l’e-mail que j’écris à propos de mon fils de 14 ans en train de rompre avec sa copine, j’aimerais assez cette publicité pour mettre fin à mon propre mariage. Ou peut-être que je réglerai tous ces trucs-là tout seul.
Le Google d’avant était un endroit génial pour travailler. Quid du nouveau ?
-1