La semaine dernière, on célébrait l’Open Access Week et j’ai eu l’occasion de donner plusieurs interventions à propos des incidences de la loi « République numérique » sur le Libre Accès aux publications scientifiques. On sait en effet que la Loi Lemaire, qui est entrée en vigueur le 8 octobre dernier, a consacré un nouveau « droit d’exploitation secondaire » au profit des chercheurs, afin de faciliter notamment le dépôt en archives ouvertes de leurs publications. Mais l’article (30) qui contient ces nouvelles dispositions n’est pas de lecture facile et il contient même plusieurs points assez délicats à interpréter. J’ai reçu ces dernières semaines de nombreuses questions de collègues qui cherchaient à avoir des précisions ou à lever des ambiguïtés, et j’ai profité des interventions à l’Open Access Week pour essayer d’apporter quelques clarifications.

De manière à ce que cela puisse profiter au plus grand nombre, je publie mon support d’intervention ci-dessous. Par ailleurs, je vais détailler certains des points abordés à travers une FAQ, de manière à mieux faire le tour de la question de manière aussi complète que possible. Si jamais vous avez besoin d’un éclaircissement complémentaire ou si une question ne vous paraît pas traitée, n’hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires et j’en profiterai pour compléter ce billet.
Je vais suivre un canevas simple (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?) dans cette FAQ pour aborder les différentes dimensions du nouveau « droit d’exploitation secondaire » consacré par la loi République numérique : Qui peut déposer ? Quels types de publication sont couvertes par le texte ? Quand le dépôt est-il possible ? Où peut-on déposer ?
A noter que sur certains points, je ne serai pas en mesure d’apporter une réponse définitive, car les ambiguïtés du texte de loi sont telles que seule une juridiction saisie dans le cadre d’un litige serait en mesure de les lever. Ce qui risque de soulever d’épineuses difficultés pratiques, car il est assez improbable qu’un tel procès ait lieu…
Ce billet sera le premier d’une série de trois que je vais consacrer aux incidences de la loi « République numérique » sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche. Le second portera sur la manière dont les universités seront impactées par le principe d’Open Data par défaut consacré par la loi Lemaire et le troisième se penchera sur les données de la recherche et sur le nouveau statut juridique que la loi va leur conférer.
Loi « République numérique » et Open Acces : une FAQ
Pour mémoire, je recopie ci-dessous le texte de l’article 30 de la loi, relatif à la question des publications scientifiques :
Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
[…] Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
A) Qui peut déposer ?
- A quoi correspond une « activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne » ?
On comprend ici qu’il s’agit des activités de recherche financées au moins à 50% par de l’argent public, notamment lorsqu’il s’agit de projets ponctuels, du type de ceux qui reçoivent le soutien financier de l’ANR, d’un Labex ou du programme H2020 de l’Union européenne.
On peut néanmoins se poser la question de savoir si les publications produites par les chercheurs en dehors d’un projet ponctuel, c’est-à-dire sans doute la majorité d’entre elles, sont couvertes par l’article 30. Dans ce cas-là, on peut considérer que c’est le salaire des chercheurs, et donc bien de l’argent public, qui finance ce type de recherches.
L’interprétation la plus vraisemblable est donc que ces publications issues de l’activité courante des chercheurs (hors projets) sont bien comprises dans le champ d’application de la loi, même s’il eut été préférable que le texte soit plus explicite sur ce point.
Déterminer si une recherche est effectuée sur fonds publics n’est pas toujours simple. On m’a demandé par exemple ce qu’il en était des travaux produits dans le cadre d’une convention CIFRE (dispositif d’accueil de doctorants par des entreprises) et la réponse me paraît en l’état difficile à donner…
2. Que se passe-t-il si le chercheur est rémunéré par l’éditeur ?
Cette hypothèse est rare, la règle voulant dans la plupart des disciplines que les chercheurs ne sont pas rémunérés pour les articles qu’ils publient dans les revues scientifiques. Mais il existe quelques exceptions, selon les politiques des éditeurs, ainsi que dans certaines disciplines (comme le droit notamment).
Dans ce cas où le chercheur est rémunéré par l’éditeur, on ne peut sans doute plus considérer que la recherche est financée par de l’argent public. On revient en effet dans un cadre classique de cession des droits contre rémunération. Du coup, le droit d’exploitation secondaire consacré par la loi ne peut alors vraisemblablement pas être opposé à l’éditer, si le chercheur lui consent une cession exclusive par le biais d’un contrat d’édition.
Il faut cependant noter que les chercheurs sont généralement payés au forfait pour des publications de type articles. A partir de quel seuil de rémunération peut-on considérer que la loi est neutralisée ? C’est difficile à dire, mais il ne serait pas logique qu’il suffise à un éditeur de verser par exemple un euro symbolique pour priver le droit d’exploitation secondaire de ses effets…
3) Les chercheurs seront-ils obligés de déposer leurs publications en Open Access lorsqu’elles sont comprises dans le champ d’application de la loi ?
La loi précise que « l’auteur dispose du droit de mettre à disposition gratuitement » sa publication. Cette formulation sous-entend que le droit d’exploitation secondaire constitue une simple faculté ouverte au bénéfice du chercheur et non une obligation.
Il appartiendra donc à chaque chercheur dont une publication est comprise dans le champ d’application de la loi de décider s’il souhaite d’opter ou non pour le Libre Accès. C’est un des points essentiels de l’équilibre de cette loi qu’il faut souligner et qui va rendre encore nécessaire l’effort de pédagogie autour de l’Open Access.
A noter cependant que si la loi n’impose pas d’obligation, il est possible que les chercheurs soient soumis à des dispositifs plus contraignants par d’autres biais. Il peut notamment s’agir de la mise en place de politique institutionnelle imposant qu’un chercheur rattaché à un établissement publie en Open Access (comme c’est le cas à l’INRIA), de l’adoption d’un mandat de dépôt obligatoire (comme à l’université d’Angers), de politiques de dépôt établies au niveau d’un laboratoire de recherche ou de la contrepartie imposée par un organisme de financement de la recherche (comme c’est le cas dans le cadre du programme européen H2020).
B) Quels types de publications peut-on déposer ?
- Que doit-on entendre par « écrit scientifique publié dans un périodique publié au moins une fois par an » ?
Cette expression couvre les publications de type articles, recensions, communications, compte-rendus, interventions, commentaires, etc. dès lors qu’elles paraissent dans un journal ou une revue ayant un rythme de parution au moins annuel.
A noter cependant que le texte précise qu’il doit s’agir d' »écrits scientifiques », ce qui peut exclure des publications de type articles dans la presse d’information générale. Une zone grise risque d’ailleurs de se former à propos des travaux de vulgarisation pour déterminer jusqu’à quel point ils constituent des « écrits scientifiques ».
On m’a aussi demandé à propos du rythme de parution ce qu’il en était pour des revues purement numériques, qui constituent davantage des bases de données que des périodiques et qui n’ont plus vraiment de périodicité régulière, les articles étant publiés au fil de l’eau. A mon sens, on peut considérer qu’il s’agit tout de même de « périodiques » d’un point de vue bibliographique et on pourra dans le doute vérifier si un ISSN leur a été attribué.
En revanche, la formulation retenue dans la loi exclut les ouvrages de type monographies, ainsi que les contributions à des ouvrages collectifs. Pour ce type de publications, les cessions de droits exclusives continueront à prévaloir si elles sont consenties par les chercheurs, sachant en plus que les éditeurs rémunèrent souvent les auteurs de monographies, ce qui bloque le droit d’exploitation secondaire comme on l’a vu plus haut.
A noter que la version initiale de l’article de loi faisait aussi référence aux « actes de congrès ou colloques ou recueils de mélanges » sans mentionner de périodicité particulière. Mais ce type de publications a été retiré de l’article au cours de la discussion parlementaire. Cela ne signifie cependant pas que le droit d’exploitation secondaire ne pourra pas jouer pour des actes de colloques ou des recueils de mélanges, mais il faudra regarder quel type de publication en est le véhicule. Si ces écrits sont publiés dans une publication périodique paraissant au moins une fois par an, le chercheur conservera le droit de publier en Open Access, mais pas s’ils sont publiés dans des monographies.
2) Quelle version d’une publication est couverte par la loi ?
Le texte précise que l’auteur a le droit de déposer en libre accès « la version finale de son manuscrit accepté pour publication« . Cela signifie que le droit d’exploitation secondaire s’applique non pas seulement au manuscrit initial soumis par le chercheur à l’éditeur, mais aussi à la version comportant les révisions intégrées suite au processus d’évaluation par un comité de lecture (peer-reviewing). L’expression « version finale acceptée pour publication » renvoie en fait à la version validée par l’auteur avec le bon-à-tirer (BAT), qui donne le feu vert à la dernière phase du processus d’édition.
Par contre, la version finale de l’article, c’est-à-dire celle comportant le texte de l’auteur inséré dans la maquette de la revue, avec la mise en page opérée par l’éditeur et l’application de la pagination, n’est pas couverte par le texte de loi. Cette version, qui correspond au « pdf éditeur » envoyé généralement à l’auteur continue à faire l’objet d’un droit exclusif appartenant à l’éditeur et ne pourra pas être déposée en libre accès par le chercheur.
Il faut noter cependant qu’un certain nombre de revues ont déclaré des politiques d’Open Access autorisant la mise en ligne du « pdf éditeur » par le chercheur et cette lattitude continuera bien sûr à prévaloir suite à l’entrée en vigueur de la loi.
3) Qu’en est-il des corrections sur épreuve ?
On m’a fait remarquer que si la loi s’applique à la dernière version certifiée par le bon-à-tirer délivré par le chercheur, ce dernier ne dispose généralement pas du fichier final comportant les corrections sur épreuve renvoyées à l’éditeur à cette occasion. La version définitive du texte de l’article incorporant ces dernières corrections ne lui revient souvent que sous la forme du pdf éditeur, que la loi ne lui permet pas de déposer en libre accès.
Cela peut poser problème dans la mesure où le chercheur se verra alors contraint de déposer une version de son article qui ne correspondra pas tout à fait à la version définitive. Une manière pour les chercheurs de surmonter cette difficulté pourrait être de demander à l’éditeur de leur transmettre un fichier sans la mise en page finale ou bien d’extraire du pdf éditeur le texte brut pour pouvoir ensuite procéder à la publication en Open Access.
Mais on peut s’attendre à ce que peu de chercheurs entreprennent de telles démarches.
4) Les illustrations accompagnant les articles sont-elles couvertes elles-aussi par la loi ?
A priori, ce n’est pas le cas, car l’article précise bien qu’il n’est applicable qu’aux « écrits scientifiques« , ce qui semble ne renvoyer qu’au texte des publications et pas aux éventuelles illustrations qui les accompagnent (photographies, schémas, graphiques, etc.).
En réalité, deux cas de figure distincts peuvent se présenter à propos des illustrations. Soit l’auteur de l’article est aussi auteur des illustrations (il a pris lui-même les photos ou réalisé les schémas et graphiques). Dans ce cas, étant titulaire des droits sur ces éléments, il sera en mesure de les faire figurer dans la version qu’il diffusera en Open Access et le droit d’exploitation secondaire prévu par la loi sera bien opposable à l’éditeur. Soit les illustrations seront couvertes par des droits appartenant à des tiers : dans ce cas, l’auteur est généralement obligé de négocier des autorisations (et éventuellement de payer une redevance) pour la publication dans la revue scientifique. Mais cette autorisation sera souvent étroitement limitée à cette première publication dans la revue et elle ne s’étendra pas ipso facto à la diffusion en libre accès. Dans cette hypothèse, la loi République numérique ne sera d’aucun secours au chercheur et il lui appartiendra d’aller négocier une nouvelle autorisation pour le dépôt en Open Access (ce qui sera généralement complexe et parfois même impossible).
A noter que si les images réutilisées pour illustrer l’article sont dans le domaine public ou sous licence Creative Commons, alors il n’y a pas d’obstacle à ce qu’elles accompagnent aussi la diffusion en Libre Accès.
5) Le droit d’exploitation secondaire peut-il être opposé à des éditeurs étrangers ?
C’est une question qui revient souvent et elle est en effet épineuse : les dispositions de la loi République numérique relative à l’Open Access seront-elles opposables aux éditeurs étrangers ou seulement à leurs homologues français ? Il est fréquent que les éditeurs étrangers fassent signer aux chercheurs des contrats d’édition soumis à la loi de leur pays d’origine (notamment américaine). Dans ce cas, la loi française se trouve-t-elle neutralisée, ce qui reviendrait à en limiter sévèrement la portée ?
A vrai dire, le Conseil d’Etat a jeté un doute sévère sur cette question de l’application territoriale du texte dans l’avis qu’il a rendu sur la loi République numérique. Il y dit notamment ceci :
En ce qui concerne la mise à disposition gratuite sur l’internet des résultats de recherches financées sur fonds publics […], le Conseil d’État a relevé que l’impact d’une telle mesure sur les contrats futurs entre éditeurs et auteurs tenait à son caractère d’ordre public, lequel ne peut jouer que sur le territoire français, alors que l’effet de la diffusion sur l’internet est mondial. Cette incohérence lui a paru faire obstacle à l’adoption de cette mesure.
Néanmoins, on voit assez mal en quoi le caractère d’ordre public des dispositions de la loi République numérique ferait obstacle à leur applicabilité aux contrats signés avec des éditeurs étrangers. On a vu en effet récemment des cas où une juridiction française a reconnu qu’une règle d’ordre public pouvait prévaloir sur les Conditions Générales d’Utilisation d’un service en ligne (dont la nature est contractuelle). Ce fut le cas notamment en février dernier dans le cadre de l’affaire opposant un citoyen français à Facebook à propos du retrait d’une publication du tableau « L’Origine du Monde » de Courbet, jugé contraire aux conditions d’utilisation du service. La Cour d’appel de Paris a estimé à cette occasion qu’était abusive la clause prévoyant que les litiges entre Facebook et ses utilisateurs ne pouvaient être jugés que par les tribunaux du Comté de Santa Clara en Californie. Les CGU de la plateforme ont été écartées au profit de l’application de la règle de principe figurant dans le Code de la Consommation.
Or on est dans un cas tout à fait comparable avec les contrats d’édition signés par les chercheurs avec des éditeurs étrangers. La loi République numérique précise explicitement que « Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite« . On ne voit donc pas au nom de quoi le même raisonnement que celui-ci tenu dans l’affaire Facebook mentionnée ci-dessus ne pourrait pas être tenu.
Contrairement à ce qu’a pu laisser entendre le Conseil d’Etat, il est donc vraisemblable de penser que la loi numérique sera bien opposable aux éditeurs étrangers.
C) Quand les chercheurs pourront-il déposer en Libre Accès ?
- Quels sont les délais d’embargo qui vont rester applicables ?
Le texte précise que les chercheurs pourront diffuser leurs publications en Libre Accès moyennant l’observation d’un « délai maximum de 6 mois dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales« , à compter de la date de la première publication par l’éditeur.
On m’a demandé si une matière comme le droit par exemple était couverte par l’article, étant donné qu’elle ne figure pas explicitement dans le texte. On peut considérer que l’intention du législateur a été de couvrir toutes les disciplines et donc qu’une matière est forcément couverte soit par un délai de 6 mois, soit par un délai de 12 mois. Pour le droit, on considérera donc qu’il relève des sciences humaines et sociales, ce qui est le plus logique.
Par ailleurs, on m’a aussi demandé ce qui se passait lorsqu’un chercheur en sociologie publiait un article dans une revue de physique… Dans ce cas, on peut estimer que la philosophie générale de la loi a plutôt l’air de fonctionner en prenant en considération le véhicule du texte plutôt que sa discipline intrinsèque. Pour un chercheur en sociologie qui publierais dans une revue de physique, on pourra donc retenir la durée de 6 mois applicable aux sciences et techniques.
Pour des revues qui seraient vraiment pluridisciplinaires ou transdisciplinaires, l’interprétation sera plus complexe, mais ces hypothèses seront sans doute assez rares.
2. Faudra-t-il attendre des décrets d’application pour que la loi devienne applicable ?
Non. L’adoption de décrets va en effet être nécessaire pour d’autres parties de la loi République numérique (notamment celle relatives à l’Open Data et à l’exception en faveur du Text et Data Mining).
Néanmoins, l’article 30 ne mentionne nullement la nécessité d’adopter des décrets et il sera donc directement applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi (c’est-à-dire le 9 octobre 2016).
3. La loi République numérique a-t-elle un effet rétroactif ?
Cette question est sans doute l’une des plus épineuse que l’on m’ait posées, mais elle revêt pourtant une importance cruciale, étant donné que selon le sens de la réponse apportée, le champ d’application du texte variera grandement.
Si cette loi n’a pas d’effet rétroactif, elle ne s’appliquera qu’aux contrats d’édition signés après sa date d’entrée en vigueur (soit le 9 octobre 2016, jour qui suit sa parution au JO). Cela signifie que pour tous les articles publiés auparavant, les délais d’embargo imposés par les éditeurs, qui peuvent être largement supérieurs à ceux prévus par le texte, continueraient à s’appliquer. On aurait donc une loi qui ne commencerait réellement à produire des effets que dans 6 mois pour les sciences exactes et dans un an pour les SHS. Si au contraire, on estime que le texte a un effet rétroactif, alors les chercheurs seraient immédiatement déliés des anciennes durées d’embargo et la loi concernait un volume de publications beaucoup plus important, incluant le stock des articles rétrospectifs.
A vrai dire, cette question de la rétroactivité du texte peut paraître surprenante, étant donné que le fameux article 2 du Code civil énonce le principe suivant :
La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Néanmoins, et contrairement à une idée reçue, cela ne signifie pas qu’une loi ne puisse pas avoir d’effets rétroactifs. Le Conseil Constitutionnel n’a en effet donné une portée absolue au principe de non-rétractivité des lois qu’en matière pénale. Et le législateur peut parfaitement déroger à ce principe général par une loi spéciale en prévoyant qu’elle aura des effets dans le passé (voir ici pour une synthèse de la question).
Il existe donc des textes de lois dotés d’une portée rétroactive, mais en général, ils le prévoient explicitement. Or c’est ici que le bât blesse avec la loi numérique, car le texte ne nous dit pas explicitement qu’il s’applique aux contrats antérieurs. Il se contente de préciser que les dispositions de l’article 30 ont un caractère d’ordre public et que « toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite ».
Mais si l’on regarde attentivement la première version du texte soumise à la consultation en ligne par le gouvernement, on constate que la formulation initiale de ce passage était différente :
Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours.
Le fait est que la dernière phrase a été supprimée lors du débat parlementaire, ce qui pourrait constituer un indice de la volonté du législateur de donner une portée rétroactive à ces dispositions.
Au final, il n’est pas facile d’apporter une réponse à cette question de la rétroactivité. Certes, la suppression de cette dernière phrase est un argument sérieux à prendre en compte. Mais dans le doute, ce serait aux tribunaux de décider en dernier ressort si la loi a un effet rétroactif ou non. Or généralement, ils ne vont pas dans ce sens lorsque le texte n’est pas explicite, sans compter qu’il y a ici des droits acquis par les éditeurs à protéger, au nom du principe de sécurité juridique. Le problème, c’est qu’il est hautement improbable que nous n’ayons jamais une décision de justice à ce sujet, car cela supposerait qu’un éditeur scientifique fasse un procès à un chercheur qui aurait déposé en Open Access un article, ce qui paraît assez improbable vu les dégâts en terme d’image que cela occasionnerait pour lui.
Du coup, on risque de rester longtemps avec une ambiguïté gênante dans le texte. Un commencement de solution pour lever ce problème pourrait consister à faire poser une question parlementaire par un député ou un sénateur au Ministre de la Recherche, de manière à ce qu’il puisse donner son interprétation. Celle-ci n’aurait pas une valeur absolue (car seule l’appréciation des juges en a une), mais elle pourrait nous donner une indication.
A défaut, il est bon de rappeler que les chercheurs qui n’auraient jamais signé de contrat d’édition en bonne et due forme avec l’éditeur (hypothèse assez fréquente dans certaines disciplines) gardent un droit plein et entier à déposer leurs publications en Open Access, y compris sans tenir compte des durées d’embargo qui pourraient avoir été déclarées par l’éditeur.
4. Que doit-on entendre lorsque la loi dit « dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique » ?
Les délais de 6 mois et 12 mois prévus par le texte ne s’appliquent que si l’éditeur n’a pas mis auparavant de son propre chef en libre accès les publications. Imaginons par exemple qu’un éditeur en SHS mette en ligne un article 6 mois après la première publication, alors l’auteur bénéfice immédiatement de son droit d’exploitation secondaire pour réaliser un auto-archivage du texte sans avoir à attendre que les 12 mois prévus par la loi soient écoulés.
On peut donc en déduire que cette règle vaudra aussi pour tous les articles publiés dans des revues en Gold Open Access (c’est-à-dire immédiatement disponibles gratuitement en ligne). Si l’on prend le cas par exemple d’une revue figurant sur le portail Revues.org et n’appliquant aucun embargo, les auteurs pourront republier immédiatement leurs textes dans une archive ouverte ou sur un site personnel.
Par ailleurs, il est utile de rappeler que les délais de 6 mois et 12 mois prévus par la loi sont explicitement qualifiés de « délais maximum ». Cela signifie que la loi n’aura pas pour effet d’imposer de telle durée d’embargo à toutes les revues : les éditeurs gardent la faculté de mettre en place des délais moins longs. Ce ne sont que les délais supérieurs qui seront à présent sans effet vis-à-vis du droit d’exploitation secondaire reconnu aux chercheurs par la loi.
D) Où les dépôts pourront être effectués ?
- Quelles sont les formes de publication autorisées par la loi ?
L’article 30 prévoit qu’est autorisée « la mise à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique ». Cette formulation est suffisamment large pour recouvrir un grand nombre d’hypothèses, comme la publication dans une archive ouverte, qu’elle soit internationale (comme ArXiv), nationale (comme HAL) ou institutionnelle. Par ailleurs, le chercheur pourra aussi procéder à un auto-archivage de son texte sur une page web du site de son laboratoire ou sur un site personnel (toutes ces hypothèses pouvant d’ailleurs se cumuler).
Cependant, la loi fixe une limite en précisant que la version mise à disposition par le chercheur en vertu de son droit d’exploitation secondaire ne peut « faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial ». On peut donc en déduire que le chercheur ne peut pas aller proposer le même texte soumis à un premier éditeur à l’un de ses concurrents, de manière à préserver l’exclusivité qui lui avait été initialement conférée.
2. Les réseaux sociaux scientifiques sont-ils couverts par la loi numérique ?
Des réseaux comme Academia.edu, Research Gate ou My Science Work sont-ils couverts par la loi numérique et les chercheurs pourront-ils exercer leur droit d’exploitation secondaire pour y publier leurs textes ?
La réponse est vraisemblablement oui, alors même que ces acteurs peuvent avoir une activité directement ou indirectement commerciale (notamment à travers l’exploitation des données personnelles ou la proposition d’options payantes à leurs utilisateurs).
En effet, la loi numérique précise que la version publiée par le chercheur ne doit pas faire l’objet d’une activité « d’édition à caractère commercial », or les réseaux sociaux scientifiques n’exercent pas d’activité éditoriale au sens propre du terme.
On peut d’ailleurs peut-être regretter que le texte de l’article 30 profite ainsi par ricochet à ces acteurs, dont le positionnement devient au fil du temps de plus en plus problématique, et qui exerce une forme de « concurrence » vis-à-vis des archives ouvertes…
3. Les chercheurs pourront-ils publier leurs travaux sous licence Creative Commons ?
On l’a vu, la loi limite les possibilités de réutilisation commerciale des publications diffusées en libre accès par les chercheurs. Or certaines licences Creative Commons (CC0, CC-BY, CC-BY-SA) autorisent les réutilisations à caractère commercial. On peut donc en déduire que le droit d’exploitation secondaire reconnu aux chercheurs ne permettra pas d’utiliser ces licences dites « libres » pour publier leurs travaux en archive ouverte ou sur un site personnel. S’ils faisaient cela, un tiers pourrait en effet venir prendre leurs textes et les rééditer à titre commercial, ce que ne permet pas la loi.
Néanmoins, il existe plusieurs licences Creative Commons (CC-BY-NC ; CC-BY-NC-SA ; CC-BY-NC-ND) qui maintiennent l’interdiction d’usage commercial. Ces licences pourront tout à fait être retenues pour la diffusion en Libre Accès des versions publiées par le chercheurs en vertu de leur droit d’exploitation secondaire. La plateforme HAL propose d’ailleurs depuis le passage à la v3 l’usage de ces licences à ses utilisateurs.
***
J’espère que ces clarifications pourront être utiles et si vous avez une question relative à l’application de ce texte qui n’est pas couverte par ce billet, n’hésitez pas à le signaler en commentaire.
Questions supplémentaires posées par les lecteurs de ce billet suite à la publication :
- La loi s’applique-t-elle aussi aux publications d’auteurs étrangers permanents ou invités dans des établissements français ?
Quand on regarde attentivement le texte, on constate que le critère principal est celui de l’origine des crédits qui financent l’article de recherche : « par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne« . Donc un chercheur étranger, officiant de manière permanente ou temporaire au sein d’un établissement français, sera à mon sens bien couvert par la loi du moment que son activité est financée à plus de 50% par de l’argent public.
On peut aussi penser que si un article est co-signé par plusieurs chercheurs, dont l’un au moins est français, et qu’il a bien été produit principalement sur des fonds publics, le chercheur français pourra procéder à une dépôt en archives ouvertes sur le fondement de la loi numérique, à condition d’obtenir l’accord des autres co-auteurs (condition mentionnée par le texte).
Classé dans:open access Tagged: archives ouvertes, auteurs, éditeurs, contrat d'édition, Libre accès, loi République numérique, open access, recherche 







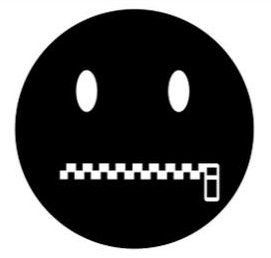
![]()



