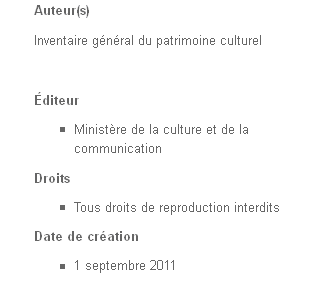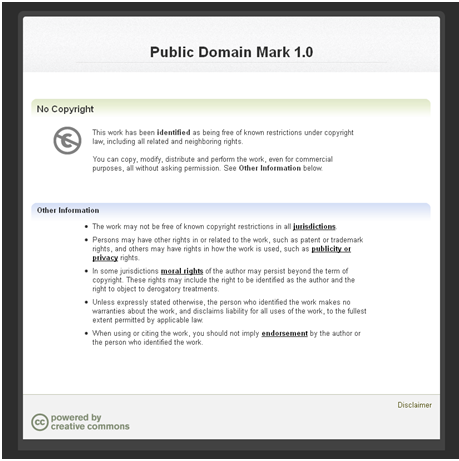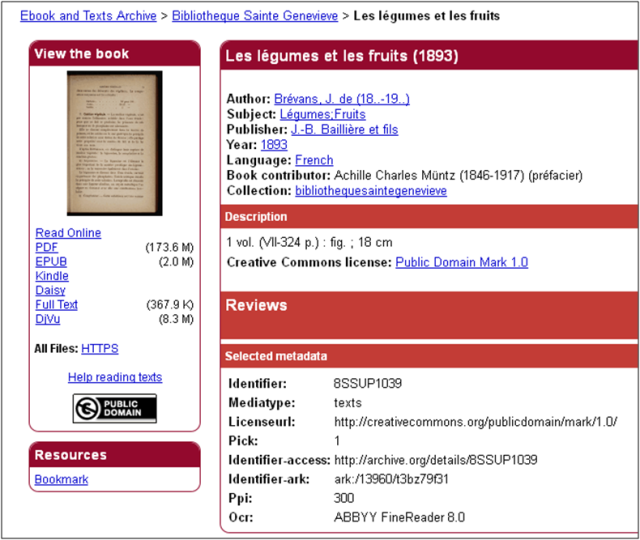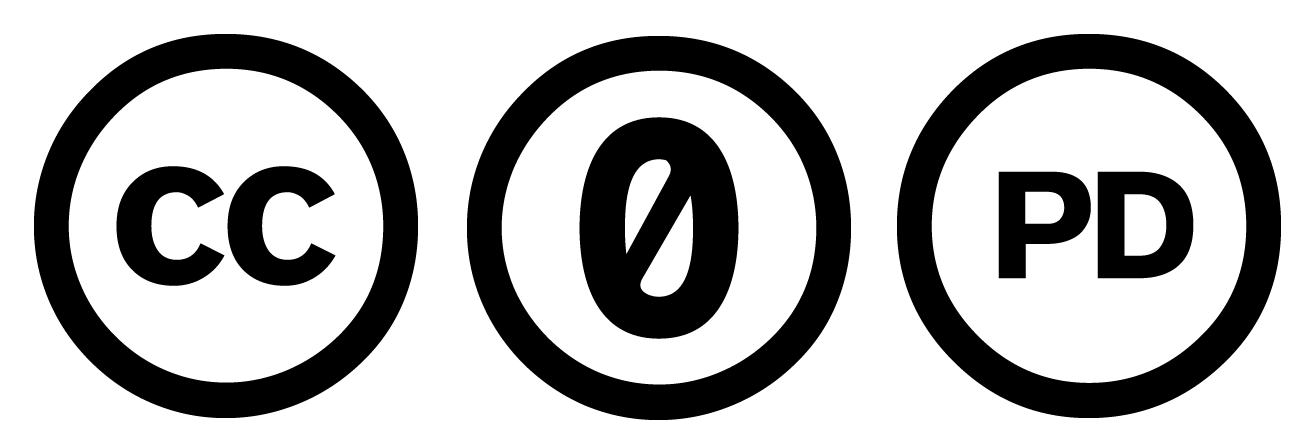« Information wants to be free », vous vous souvenez ?
vendredi 23 novembre 2012 à 18:22C’est sans doute l’une des phrases les plus célèbres prononcées à propos d’Internet : en 1984, l’auteur américain Stewart Brand lance au cours de la première Hacher’s Conference organisée en Californie :
Information wants to be free.
Ces mots deviendront l’un des slogans les plus forts du mouvement de la Culture libre et ils rencontrent encore aujourd’hui des échos importants, avec l’affaire Wikileaks par exemple, les révolutions arabes ou le mouvement de l’Open Data. L’idée de base derrière cette formule consiste à souligner que l’information sous forme numérique tend nécessairement à circuler librement et c’est la nature même d’un réseau comme internet de favoriser cette libération.
Mais les choses sont en réalité un peu plus complexes et Stewart Brand dès l’origine avait parfaitement conscience que la libre circulation de l’information était un phénomène qui engendrerait des conflits :
On the one hand information wants to be expensive, because it’s so valuable. The right information in the right place just changes your life. On the other hand, information wants to be free, because the cost of getting it out is getting lower and lower all the time. So you have these two fighting against each other.
D’un côté, l’information veut avoir un prix, parce qu’elle a une grande valeur. Obtenir la bonne information au bon endroit peut tout simplement changer votre vie. D’un autre côté, l’information veut être libre, parce que le coût pour la produire devient de plus en plus faible. Nous avons une lutte entre ces deux tendances.
Ce conflit latent traverse toute l’histoire d’Internet et il atteint aujourd’hui une forme de paroxysme qui éclate dans une affaire comme celle de la Lex Google.
Encapsuler l’information
Pour obliger le moteur de recherche à participer à leur financement, les éditeurs de presse en sont à demander au gouvernement de créer un nouveau droit voisin à leur profit, qui recouvrira les contenus qu’ils produisent et soumettra l’indexation, voire les simples liens hypertexte, à autorisation et à redevance.
Il est clair que si de telles propositions se transforment en loi dans ces termes, la première tendance de Stewart Brand aura remporté une victoire décisive sur l’autre et une grande partie des informations circulant sur Internet ne pourra plus être libre. La Lex Google bouleverserait en profondeur l’équilibre juridique du droit de l’information.
En effet, c’était jusqu’alors un principe de base que le droit d’auteur protège seulement les oeuvres de l’esprit, c’est-à-dire les créations originales ayant reçu un minimum de mise en forme. Cette notion est certes très vaste puisqu’elle englobe toutes les créations quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, mais elle ne s’applique pas aux idées, aux données brutes et à l’information qui ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation et demeurent « de libre parcours ».
Ces éléments forment un « fonds commun », comme le dit le professeur Michel Vivant, dans lequel chacun peut venir puiser librement sans entrave pour alimenter ses propres réflexions et créations. Tout comme le domaine public, ce fonds commun joue un rôle primordial dans l’équilibre du système, afin que le droit d’auteur n’écrase pas d’autres valeurs fondamentales comme le droit à l’information ou la liberté d’expression.
Créer un droit voisin sur les contenus de presse reviendrait à « encapsuler » l’information dans une carapace juridique et à anéantir une grande partie de ce domaine public informationnel. L’information en elle-même, et non son expression sous forme d’articles, passerait subitement en mode propriétaire, avec peut-être même une mise en péril du simple droit à la citation.
A vrai dire, cette tendance à l’appropriation existe depuis longtemps. Elle s’est déjà manifestée par la création d’un droit des bases de données dans les années 90, dont l’application soulève de nombreuses difficultés. Des signes plus récents montrent qu’un revirement plus profond encore est en train de s’opérer dans la conception de la protection de l’information.
Les dépêches de l’AFP ont ainsi longtemps bénéficié d’une sorte de statut dérogatoire, comme si l’information brute qu’elle contenait et qu’elles étaient destinées à véhiculer primait sur le droit à la protection. Les juges considéraient traditionnellement que ces dépêches n’étaient pas suffisamment originales pour qu’on puisse leur appliquer un droit d’auteur, ce qui garantissait leur libre reprise. Mais l’AFP s’est efforcée de renverser le principe, en attaquant dès 2005 Google News devant les tribunaux, ce qui préfigurait d’ailleurs très largement les débats autour de la Lex Google.
Or en février 2010, le Tribunal de commerce de Paris a reconnu que les dépêches pouvaient présenter une certaine forme d’originalité susceptible d’être protégée :
[...] Attendu que les dépêches de l’AFP correspondent, par construction, à un choix des informations diffusées, à la suite le cas échéant de vérifications de sources, à une mise en forme qui, même si elle reste souvent simple, n’en présente pas moins une mise en perspective des faits, un effort de rédaction et de construction, le choix de certaines expressions [...]
L’affaire a été portée en appel, mais en attendant, l’information brute se trouve bien à nouveau recouverte par le droit d’auteur.
Demain, tous des parasites informationnels ?
Une affaire récente, qui a défrayé la chronique, va encore plus loin et elle pourrait bien avoir des retentissements importants, puisqu’elle tend à faire de chacun de nous des parasites en puissance de l’information, attaquables devant les tribunaux.
Jean-Marc Morandini vient en effet d’être condamné à verser 50 000 euros au journal Le Point, qui l’accusait de piller régulièrement la partie Médias 2.0 de son site, afin d’alimenter ses propres chroniques. Le jugement de la Cour d’Appel de Paris qui a prononcé cette condamnation est extrêmement intéressant à analyser, car il nous ramène au coeur de la tension autour de l’information libre formulée par Stewart Brand.
En effet, le juge commence logiquement par examiner si les articles repris sur Le Point peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Et là, surprise, sa réponse est négative, en vertu d’un raisonnement qui rappelle la position traditionnelle sur les dépêches AFP. La Cour estime en effet que les brèves figurant dans cette rubrique Medias 2.0 constituent des articles « sans prétention littéraire, ne permet[tant] pas à leur auteur, au demeurant inconnu, de manifester un véritable effort créatif lui permettant d’exprimer sa personnalité ». C’est dire donc qu’elles ne sont pas suffisamment originales pour entrer dans le champ du droit d’auteur, le journaliste qui les rédige (Emmanuel Berretta) se contentant de diffuser de l’information brute.
Nous sommes donc bien en dehors de la sphère de la contrefaçon, mais les juges ont tout de même estimé que Morandini méritait condamnation, sur la base du fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme. La Cour reconnaît que le journaliste imite Le Point « avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, notamment en modifiant les titres des brèves et articles repris », mais elle ajoute qu’il tend ainsi ainsi « à s’approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d’efforts intellectuels de recherches et d’études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés ». Plus loin, elle explique qu’ « il ne suffit pas d’ouvrir une brève par la mention « Selon le journal Le Point » pour s’autoriser le pillage quasi systématique des informations de cet organe de presse, lesquelles sont nécessairement le fruit d’un investissement humain et financier considérable ».
On est donc en plein dans la première partie de la citation de Stewart Brand : « information wants to be expensive, because it’s so valuable« . L’avocat du Point commentait de son côté la décision en ces termes :
Qu’il y ait une circulation de l’information sur Internet, du buzz, des reprises…, c’est normal, c’est la vie du Web, reprend Me Le Gunehec. Nous l’avions dit franchement à la cour d’appel, et elle le sait bien. Mais elle a voulu rappeler qu’il y a une ligne jaune : se contenter de reprendre les informations des autres, sous une forme à peine démarquée, avec quelques retouches cosmétiques pour faire croire à une production maison, cela ne fait pas un modèle économique acceptable. Et on pourrait ajouter : surtout quand cette information est exclusive.
Cette dernière phrase est très importante. Ce qu’elle sous-entend, c’est que celui qui est à l’origine d’une information exclusive devrait pouvoir bénéficier d’un droit exclusif sur celle-ci pour pouvoir en contrôler la diffusion et la monétiser. La logique du droit jusqu’à présent était pourtant exactement inverse : pas de droit exclusif sur l’information elle-même… même (voire surtout) exclusive !
Sans avoir aucune sympathie particulière pour Morandini, il faut considérer qu’un tel raisonnement peut aboutir à faire de nous tous des parasites de l’information en puissance, car nous passons notre temps à reprendre des informations piochées en ligne sur Internet (moi le premier). Certains commentaires ont d’ailleurs fait remarquer à juste titre que cette jurisprudence heurtait de front le développement des pratiques de curation de contenus en ligne.
Revendiquer un droit exclusif sur l’information brute elle-même, différent du droit d’auteur sur son expression, c’est d’une certaine façon courir le risque de permettre l’appropriation de la réalité elle-même. Qu’adviendrait-il d’un monde où l’information serait ainsi protégée ? Certains ont essayé de l’imaginer.
Un monde où l’information est copyrightée ?
Il se trouve que la science-fiction a déjà exploré cette possibilité et la vision qu’elle nous livre est assez troublante. Elle donne beaucoup à réfléchir sur cette crispation que l’on constate à propos du droit de l’information.
Dans sa nouvelle d’anticipation »Le monde, tous droits réservés« figurant dans le recueil éponyme, l’auteur Claude Ecken imagine justement un monde dans lequel l’information pourrait être copyrightée et les conséquences que cette variation pourrait avoir sur les médias et la société dans son ensemble.

Dans un futur proche, l’auteur envisage que la loi a consacré la possibilité de déposer un copyright sur les évènements, d’une durée de 24 heures à une semaine, qui confère un droit exclusif de relater un fait, empêchant qu’un concurrent puisse le faire sans commettre un plagiat. A l’inverse de ce qui se passe aujourd’hui avec la reprise des dépêches des agences AFP ou Reuters, les organes de presse se livrent à une lutte sans merci pour être les premiers à dénicher un scoop sur lequel elles pourront déposer un copyright.
L’intérêt de la nouvelle est de développer dans le détail les implications juridiques et économiques d’un tel mécanisme. Les témoins directs d’un évènement (la victime d’une agression, par exemple) disposent d’un copyright qu’ils peuvent monnayer auprès des journalistes. Lorsqu’une catastrophe naturelle survient, comme un tremblement de terre, c’est cette fois le pays où l’évènement s’est produit qui détient les droits sur l’évènement, qu’elle vendra à la presse pour financer les secours et la reconstruction.
Et immanquablement, cette forme d’appropriation génère en retour des formes de piratage de l’information, de la part de groupuscules qui la mettent librement à la disposition de tous sous la forme d’attentats médiatiques, férocement réprimés par le pouvoir en place, ce qui rappelle étrangement l’affaire Wikileaks, mais transposée à l’échelle de l’information générale.
Si Claude Ecken s’applique à démontrer les dangers d’un tel système, il laisse aussi son héros en prendre la défense :
Avant la loi de 2018, les journaux d’information se répétaient tous. Leur spécificité était le filtre politique interprétant les nouvelles selon la tendance de leur parti. Il existait autant d’interprétations que de supports. Le plus souvent, aucun des rédacteurs n’avait vécu l’évènement : chacun se contentait des télex adressés par les agences de presse. On confondait journaliste et commentateur. Les trop nombreuses prises de position plaidaient en faveur d’une pluralité des sources mais cet argument perdit du poids à son tour : il y avait ressassement, affadissement et non plus diversité. L’information était banalisée au point d’être dévaluée, répétée en boucle à l’image d’un matraquage publicitaire, jusqu’à diluer les événements en une bouillie d’informations qui accompagnait l’individu tout au long de sa journée. Où était la noblesse du métier de journaliste ? Les nouvelles n’étaient qu’une toile de fond pour les médias, un espace d’animation dont on ne percevait plus très bien le rapport avec le réel. Il était temps de revaloriser l’information et ceux qui la faisaient. Il était temps de payer des droits d’auteur à ceux qui se mouillaient réellement pour raconter ce qui se passait à travers le monde.
Dans un commentaire de la décision rendue à propos de Morandini, on peut lire ceci : « Même sur Internet, le journaliste se doit d’aller chercher lui-même l’information !« . Vous voyez donc que l’on n’est plus très loin de l’histoire imaginée par Claude Ecken…
***
Information wants to be free… c’était le rêve qu’avait fait la génération qui a assisté à la mise en place d’internet, puis du web, et ce rêve était beau. Mais la puissance de la pulsion appropriatrice est si forte que c’est une dystopie imaginée par la science-fiction qui est en train de devenir réalité, à la place de l’utopie d’une information libre et fluide. Avec l’information brute, c’est la trame de la réalité elle-même que l’on rend appropriable, ce qui rappelle également les dérives dramatiques que l’on avait pu constater lors des derniers Jeux Olympiques de Londres, à l’occasion desquels les autorités olympiques ont défendu leurs droits exclusifs sur l’évènement avec une férocité alarmante.
Il existe pourtant une autre façon de concevoir les choses, à condition de quitter le prisme déformant des droits exclusifs. Au début de la polémique sur la Lex Google, j’avais en effet essayé de montrer que l’on peut appliquer le système de la légalisation du partage non-marchand aux contenus de presse et, couplé à la mise en place d’une contribution créative, il pourrait même assurer aux éditeurs et aux journalistes des revenus substantiels tout en garantissant la circulation de l’information et la liberté de référencer.
L’information veut être libre, c’est sa nature même, mais il nous reste à le vouloir aussi…
Classé dans:Quel Droit pour le Web 2.0 ? Tagged: AFP, copyright, droit d'auteur, droit voisin, Google, information, Lex Google, morandini, presse, science-fiction