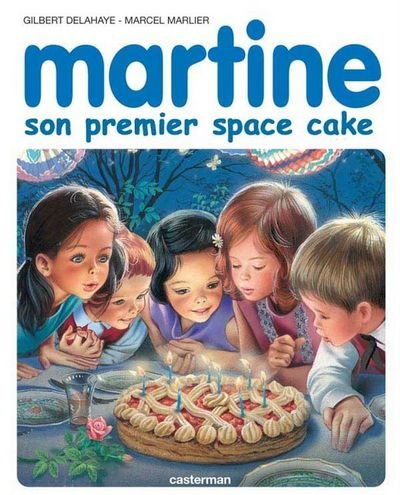Hadopi et la Rémunération du Partage : pour en finir avec le Storytelling
samedi 6 septembre 2014 à 17:28La Hadopi a publié cette semaine un rapport intermédiaire sur les travaux qu’elle a engagés depuis un an maintenant sur la "Rémunération Proportionnelle du Partage".
J’ai déjà eu l’occasion d’écrire plusieurs fois à ce sujet (ici ou là) pour commenter les propositions faites dans ce cadre. En juin dernier, afin de pouvoir approfondir la discussion, j’avais invité Éric Walter, secrétaire général de la Hadopi, et Thierry Crouzet, auteur, lors de "Pas Sage en Seine" pour un débat, afin de mieux cerner les points de convergence et de divergence entre les différentes solutions avancées pour légaliser le partage en ligne des oeuvres. La discussion avait pu se faire de manière relativement constructive – ce qui n’est pas si fréquent sur un tel sujet – et la vidéo mérite d’être à nouveau regardée, avant de se plonger dans les nouveautés ou précisions apportées par ce rapport.
Nos échanges avaient en effet permis de bien cerner ce qui différencie les propositions de la Hadopi de celles que La Quadrature du Net pousse depuis plusieurs années. La Quadrature demande en effet la légalisation du partage non-marchand entre individus, c’est-à-dire une transmission de fichiers s’effectuant selon des moyens décentralisés et sans but de profit. La Hadopi de son côté a choisi de retenir une approche plus large. Après quelques hésitations initiales, elle a décidé d’englober dans ses propositions de légalisation à la fois les échanges décentralisés, mais aussi les échanges centralisés s’effectuant par le biais de plateformes ou avec l’aide d’intermédiaires techniques. Lorsque ceux-ci tirent un bénéfice commercial de ces échanges, la Hadopi propose de les soumettre au paiement d’une redevance proportionnelle, reversée aux titulaires de droits pour compenser le manque à gagner. La Rémunération Proportionnelle du Partage serait donc acquittée par ces plateformes et intermédiaires (pouvant être des acteurs aussi variés que DPstream, T411, Mega, The Pirate Bay, mais aussi YouTube, Facebook, Dropbox ou WeTransfer).
Du côté de la Quadrature, nous refusons cette logique compensatoire, au motif que le partage constitue un droit culturel fondamental et que le préjudice causé aux industries culturelles n’a jamais été établi. Mais pour assurer le financement de la création, et notamment dégager des ressources pour un grand nombre de créateurs, y compris les amateurs foisonnant sur Internet, nous proposons de mettre en place un financement mutualisé – appelé contribution créative – sous la forme d’un surcoût à l’abonnement Internet payés par les foyers et reversé ensuite aux créateurs. Avec les propositions de la Quadrature, les échanges centralisés d’oeuvres resteraient illégaux et un MegaUpload par exemple n’aurait pas pu profiter de ce disposition de légalisation, ce qui n’est pas le cas avec les propositions de la Hadopi.
Le rapport qui vient d’être publié fait état de ces divergences et expose d’ailleurs de manière relativement fidèle les propositions de la Quadrature, ainsi que d’autres solutions alternatives – et il faut le saluer. Sur le fond, je ne dirais pas que cette publication apporte beaucoup d’éléments nouveaux par rapport à ce que la Hadopi avait déjà fait connaître, mais elle contient des précisions intéressantes quant aux outils conceptuels et à la méthodologie utilisés.
De cette lecture, je retire trois séries d’observations :
1) Le rapport dresse un schéma conceptuel intéressant, dénommé "abstraction du partage", pour établir une typologie des différentes formes d’échanges en ligne. Il rejoint aussi dans certaines de ses conclusions les positions de La Quadrature, sur des aspects non négligeables, notamment la méthode d’évaluation des usages en ligne.
2) Le rapport contient une ambiguïté au niveau de la détermination du périmètre des intermédiaires assujettis au paiement de la redevance. En effet, le système de rémunération proposé par la Hadopi fonctionne avec un "seuil plancher". Sont redevables de la redevance soit les acteurs intermédiaires ne tirant aucun avantage économique des échanges, soit ceux tirant un avantage restant en deçà de ce seuil. Mais la formulation est floue quant à la détermination exacte de ces acteurs. Il est dit par endroits qu’il peut s’agir "de sites web non-lucratifs" ou "d’acteurs tirant de faibles revenus du partage tels que les services de webmail". Or si un site est "non-lucratif", il pourrait très bien tirer des revenus substantiels du partage (par le biais de dons ou de publicités), à condition qu’il les réinvestisse ensuite dans ses infrastructures sans chercher à faire de bénéfices. Ce type d’acteurs "hybrides", pouvant jouer un rôle utile dans l’écosystème du partage (on pense par exemple à des trackers, à des annuaires de liens ou à des forums), seraient-il exonérés du paiement de la redevance de la Hadopi ? Dans l’état des propositions, c’est difficile à déterminer.
3) La partie économique du rapport contient à mon sens une grosse faille méthodologique, lorsque la Hadopi essaie de modéliser les conséquences possibles d’une légalisation du partage sur les comportements des individus. C’est dû à mon sens au fait que le rapport cherche constamment à minimiser la part des échanges décentralisés dans le partage des oeuvres en ligne, pour faire passer l’idée que le P2P décentralisé des origines étant mort, les échanges auraient déjà massivement migré vers des formes de contrefaçon commerciale, impliquant des intermédiaires cherchant à faire du profit. Or non seulement la preuve de cette affirmation n’est pas réellement apportée dans l’étude, mais le fait de partir d’une telle hypothèse fausse à mon sens complètement le modèle mis en place par les économistes travaillant pour la Hadopi.
Pour cette dernière raison, je continue à penser que ces travaux de la Hadopi constituent avant tout une forme de Storytelling, plus qu’une démarche scientifique rigoureuse contrairement à l’ambition qu’elle affiche. Partant de prémisses qui ont été posées a priori pour arriver à un résultat donné, la démarche prête le flanc à de fortes critiques au niveau de la méthode suivie. Le rapport peut en outre se lire à deux niveaux, car la Hadopi y distille des idées non-démontrées alimentant un discours qui se déploie par ailleurs pour justifier la mise en place de moyens de répression contre la "contrefaçon commerciale". C’est ce que l’on a vu notamment à travers les propositions du rapport Imbert-Quaretta rendues au mois de mai dernier. Ce discours devrait rapidement déboucher, non pas sur une légalisation du partage telle que la Hadopi la décrit dans son rapport, mais sur l’introduction de nouvelles mesures répressives dont j’ai déjà parlé dans S.I.Lex, risquant de conduire à un catastrophique "SOPA à la française". On voit en effet que dès la nomination de Fleur Pellerin au Ministère de la Culture, ses premiers mots ont été pour annoncer sa volonté de lutter contre le "piratage" et des travaux ont immédiatement été confiés au CSPLA pour concrétiser les propositions de Mireille Imbert-Quaretta, impliquant blocage, filtrage, liste noire, "Stay down" et autres horreurs que les industries culturelles réclament à corps et à cri…
1) Un schéma conceptuel intéressant et des convergences sur des points importants
La Hadopi avait déjà réalisé dans sa précédente étude une "cartographie" des formes de partage en ligne et elle propose cette fois une "abstraction du partage", permettant d’identifier les fonctions des différents acteurs impliqués selon les formes d’échanges. Elle aboutit à distinguer des formes de partage "synchrone" (usage de cyberlockers, de plateformes de streaming ou de newsgroups) des formes de partage "asynchrone" (usage de réseau P2P ou Torrent, IRC ou messagerie instantanée). La modélisation est intéressante en ce qu’elle montre la complexité de l’écosystème du partage, avec notamment le rôle de "balises" permettant aux internautes de s’orienter pour trouver les fichiers sur les serveurs ou de "points de rendez-vous" pour référencer les internautes partageant les contenus.
Par ailleurs, la Hadopi rejoint La Quadrature concernant les moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les échanges d’oeuvres afin de déterminer les montants d’argent à répartir vers les créateurs. La difficulté étant qu’il faut arriver à ce que ces mesures soient fiables, sans pour autant qu’elles ne débouchent sur des formes de surveillance des internautes, ce qui serait inacceptable. Le rapport évoque des "mesures d’audience évoluée, inspirées de la mesure d’audience audiovisuelle telle que pratiquée par les instituts spécialisés et fondés sur l’analyse des données de consultation en temps réels fournis par des panels d’utilisateurs volontaires", solution proposée notamment par Philippe Aigrain dans son ouvrage Sharing pour la contribution créative. La Hadopi estime "qu’il est tout à fait impossible d’imaginer des terminaux de récoltes des données", mais elle ajoute sans doute à raison que cette méthode pose problème pour mesurer les échanges d’oeuvres partagées à des échelles réduites. Il sera intéressant de voir dans la suite des travaux de la Hadopi ce qu’elle propose comme solution pour remédier à cette difficulté, importante si l’on veut que la légalisation du partage puisse faire apparaître la Longue Traîne.
Enfin et ce n’est pas anodin, la Hadopi estime que les obstacles juridiques traditionnellement avancés à la légalisation du partage, comme "l’incompatibilité avec la constitution" ou "les accords internationaux" ne "devraient pas être insurmontables". Mais le détail sur ces aspects juridiques est renvoyé à un rapport ultérieur. Au niveau du fondement juridique à employer pour légaliser le partage, la Hadopi se prononce cependant déjà en faveur d’une nouvelle "gestion collective imposée", de manière à éviter l’intervention du législateur européen. Elle écarte le fondement proposé par La Quadrature du Net, à savoir l’extension de l’épuisement du droit de distribution "pour des raisons développées dans le rapport final". Cette question est pourtant très importante, car si l’extension de l’épuisement des droits ne peut en effet être mis en oeuvre qu’au niveau européen, elle présente l’intérêt de ne pas avoir à répartir les sommes collectées à travers le système traditionnel de gestion collective, alors que la solution proposée par la Hadopi aurait pour effet d’alimenter directement les SACEM, SACD et Cie, avec tous leurs travers traditionnels…
2) Une ambiguïté gênante sur les intermédiaires assujettis à la redevance
Ce rapport de la Hadopi reprend une idée figurant dans leur rapport précédent, que j’avais déjà saluée comme un point positif de la démarche. En effet, la Hadopi estime que le partage non-marchand ne doit pas faire l’objet d’une compensation financière, ce que beaucoup de tenants de la légalisation, à la Quadrature ou au Parti Pirate par exemple, revendiquent depuis longtemps, puisque l’on a jamais réussi à apporter la preuve d’un préjudice causé aux industries culturelles du fait du partage.
La Hadopi va même plus loin vu qu’elle ajoute qu’un "seuil plancher" devrait être mis en place pour que certains intermédiaires, tirant un avantage financier des échanges, ne soient pas assujettis au paiement de la redevance (voir cet extrait du premier rapport) :
Dans le cas minoritaire des usages entraînant aucun gain, la rémunération due est égale à 0.
Il existe par ailleurs un seuil en deçà duquel, la rémunération est supposée égale à 0. Cela recouvre les cas usages entraînant que de très faibles gains et les intermédiaires dont l’implication dans la chaîne de consommation est marginale (coefficient très faible).
Sauf que la formulation change avec ce nouveau rapport et que cette fois, la Hadopi parle plutôt d’exclure de l’obligation de payer cette redevance des "sites web non-lucratifs". Or ce n’est pas du tout la même chose, si les mots ont bien un sens. Je peux réaliser des gains financiers à partir d’une activité et à ce moment, mon activité sera considérée comme "lucrative". Mais je peux aussi être une entité qui réalise des gains financiers importants, tout en restant "non-lucrative", si je les réinvestis dans mon activité. Pour prendre un exemple, la Wikimedia Foundation reçoit chaque année des dons se chiffrant en millions de la part des internautes, mais il ne s’agit pas d’un site "lucratif" dans la mesure où ces sommes sont réinvesties pour maintenir l’infrastructure nécessaire à la pérennité de Wikipédia.
Si l’on prend le cas du partage, il existe tout un ensemble d’intermédiaires qui peuvent jouer un rôle utile dans l’écosystème, comme les trackers, les annuaires de liens, les forums, et qui ont des besoins en termes de financement pour maintenir eux-aussi leurs infrastructures. Imaginons que ces sites fassent des gains financiers, par le biais de dons versés par les internautes, voire même de publicités. S’ils réinvestissent ces gains pour l’entretien de leurs serveurs et le développement de leur site, sans chercher à faire de profit, de tels intermédiaires seraient-ils soumis ou non au paiement de la redevance envisagée par la Hadopi ?
C’est aussi une question qui s’est posée du côté de la Quadrature du Net. Nos propositions concernent le partage non marchand entre individus et nous cherchons à promouvoir des formes décentralisées d’échanges. Mais des intermédiaires utiles peuvent intervenir dans ces échanges, sans pour autant que ceux-ci se "recentralisent". Les annuaires de liens, les trackers, les forums n’hébergent pas les fichiers ; ils se contentent d’orienter les utilisateurs par le biais de liens hypertexte. Et le programme de la Quadrature contient une partie sur la "légitimité de la référence" qui porte justement sur ce rôle des liens hypertexte :
Il existe un lien entre cette liberté générale de référence et la reconnaissance légale du partage non marchand d’œuvres numériques entre individus proposée dans le point précédent. Dans le contexte de cette reconnaissance, le fait de créer des répertoires de liens vers des fichiers numériques rendant possible la pratique de ce partage est une activité légitime, qu’elle soit pratiquée par des acteurs commerciaux ou non. A l’opposé, la centralisation sur un site d’œuvres numériques relève toujours de l’application du droit d’auteur ou copyright et reste soumise à autorisation ou licence collective
Cela signifie que dans notre modèle, nous admettons que des sites de type annuaires de liens, trackers ou forums puissent intervenir comme intermédiaires dans le partage non-marchand entre individus et bénéficier de la légalisation, même s’ils réalisent des gains financier du fait de cette activité "d’auxiliaires du partage".
Cette conception pourrait d’ailleurs très bien se combiner avec la proposition de la Hadopi d’exempter les "sites non-lucratifs". Pour prendre un exemple bien connu, un acteur comme The Pirate Bay pourrait continuer à exister et à se financer par des dons et de la publicité, mais uniquement à condition qu’il réinvestisse ces sommes dans le maintien et le développement de son infrastructure, sans chercher à faire de profits. Une telle solution aurait l’avantage de permettre à des intermédiaires "communautaires" d’exister dans l’écosystème du partage, en assurant leur viabilité. Mais en l’état, les propositions de la Hadopi sont trop ambiguës pour que l’on puisse savoir si cette interprétation de leur "seuil plancher" est recevable.
Notons par ailleurs que toujours sur ce chapitre des intermédiaires soumis ou non au paiement de la redevance, la Hadopi continue à exclure de manière inexplicable les FAI, qui sont pourtant pleinement impliqués dans les pratiques de partage :
Si le périmètre des intermédiaires assujettis doit être défini de façon large, on doit garder en tête la volonté d’exclure certains acteurs et en particulier les FAI, pour la raison que leur modèle économique ne repose pas ou ne poursuit pas comme objectif le partage des oeuvres entre individus.
On voit mal ce qui vient rationnellement justifier cette exclusion des FAI et en quoi leur modèle économique dépend plus ou moins du partage que les services comme Dropbox ou WeTransfer que la Hadopi semble pourtant vouloir inclure parmi les catégorie d’acteurs pouvant être soumis au paiement de la redevance. La seule raison véritable, c’est qu’inclure les FAI reviendrait au final à retomber sur un système de licence globale ou de contribution créative, puisque les fournisseurs d’accès répercuteraient le montant de la redevance sur le prix de leurs abonnements. Et cela, la Hadopi veut l’éviter pour marquer l’originalité de ces propositions.
Ce type de paralogisme est très malvenu dans le rapport, car il décrédibilise la démarche de la Hadopi, intéressante pourtant par certains côtés. Mais ce genre de biais est encore plus éclatant dans la partie économique du rapport, lorsque la Hadopi essaie d’envisager les conséquences possibles de la légalisation du partage sur le comportement des individus.
3) Une grosse faille méthodologique dans l’anticipation des conséquences de la légalisation du partage
La Hadopi utilise un modèle développé en partenariat avec l’INRIA pour essayer de déterminer comment les individus réagiraient dans l’hypothèse où le partage serait légalisé et la Rémunération Proportionnelle du Partage mise en place. Ce modèle économétrique est représenté sur le schéma ci-dessous :

Pour faire simple, ce modèle distingue trois catégories d’individus : ceux qui ont une "consommation directe" d’oeuvres culturelles (c’est-à-dire ceux qui se fournissent par le biais de l’offre légale actuelle), ceux qui consomment à travers des intermédiaires (ceux qui se fournissent par le biais de l’offre illégale, type Streaming ou DirectDownload) et ceux qui n’ont pas du tout de consommation de biens culturels sous forme numérique.
La Hadopi estime qu’en cas de légalisation selon les modalités qu’elle prône, une partie de ceux qui avaient une consommation directe via l’offre légale se reporteraient sur la consommation à travers des intermédiaires, sur la base d’arguments du type : «ils sont connus, ils sont légaux, j’ai moins peur d’être hors la loi, moins peur des virus, etc.» Une partie aussi des non-consommateurs actuels pourraient être incités à développer leur consommation via des intermédiaires. La question pour la Hadopi est donc de savoir si la Rémunération Proportionnelle du Partage, levée sur ces intermédiaires, suffira à compenser les pertes subies du fait du repli de la consommation directe (offre légale actuelle). Sans quoi les industries culturelles seraient lésées et le modèle devrait sans doute être rejeté.
Mais il y a un biais énorme dans le raisonnement de la Hadopi. Ce schéma omet déjà complètement d’emblée le partage décentralisé entre individus, utilisant des protocoles comme le P2P. La Hadopi prend soin dans une autre partie du rapport d’affirmer que cette forme de partage serait devenue ultra-minoritaire aujourd’hui, puisqu’il ne représenterait selon elle que 2% des échanges illicites. Cette affirmation n’est pas démontrée et elle dépend entièrement de ce que l’on entend par "échanges décentralisés".
Mais si les usages se sont déportés du P2P vers des formes centralisés d’échanges impliquant des intermédiaires marchands, comme le streaming ou le DirectDownload, c’est en grande partie parce que la répression, et notamment en France la riposte graduée, ne cible que les échanges décentralisés en P2P et ne peut pas agir sur le streaming ou le DirectDonwload. Soit les internautes ont délaissé le P2P en sachant qu’ils ne risquaient rien en allant vers des sites centralisés (c’est ce qui a expliqué en partie le succès de MegaUpload), soit ils se sont mis à utiliser des intermédiaires techniques pour se protéger et éviter de voir leur adresse IP "flashée" par la Hadopi. Par exemple, beaucoup d’entre nous utilisent des services comme des VPN, des proxys ou des Seedboxs afin de pouvoir continuer à télécharger en P2P sans ennui. Or ces services sont généralement payants si l’on veut qu’ils soient vraiment efficaces. Pour la Hadopi, il s’agit d’une forme de "consommation via intermédiaires", mais les intermédiaires en question perdraient tout leur intérêt si le partage était légalisé et qu’il n’était plus nécessaire de protéger son IP.
Du coup, et c’est ce que la Hadopi n’envisage pas du tout dans son modèle économétrique, on peut penser que la légalisation du partage aurait pour effet de provoquer un retour des usages vers des formes d’échanges décentralisés et non-marchands. Quel intérêt de continuer à payer un abonnement mensuel à un service de streaming ou de DirectDownload s’il est possible d’avoir accès aux oeuvres gratuitement par ailleurs sans risque légal ? Dans une autre partie de son rapport, la Hadopi affirme que la répression n’est pas la seule explication du passage des formes décentralisées d’échanges, type P2P, à des formes centralisées, car celles-ci seraient techniquement plus commodes à utiliser. C’est sans doute vrai, mais on voit aujourd’hui se développer des services comme Popcorn Time (le "Netflix des pirates") par exemple, s’appuyant sur des échanges décentralisés tout en bénéficiant d’une ergonomie très poussée. Popcorn Time est dans le radar de la Hadopi, mais il a déjà séduit plusieurs centaines de milliers de français. En cas de légalisation du partage, il est plus que probable que de tels services connaîtraient un gros boum dans leur utilisation. Or cette hypothèse n’apparaît même pas dans le modèle économétrique de la Hadopi !
Or quel serait l’effet de cette omission pour les créateurs et les filières culturelles ? Comme la Hadopi n’envisage que de soumettre à redevance les intermédiaires commerciaux, une partie substantielle des échanges se déporterait vers des formes décentralisées gratuites, type P2P, ou portées par des sites "non-lucratifs" et aucun revenu n’irait aux créateurs puisque ces acteurs seraient exonérés de redevance… Alors qu’avec la solution prônée par la Quadrature du Net, la contribution créative serait acquittée par les abonnés à Internet, ce qui signifie que les échanges non-marchands décentralisés seraient sources de nouveaux revenus pour les créateurs. La proposition de la Hadopi me paraît donc risquée et biaisée, car elle sous-estime l’effet de la répression sur les comportements et la résilience des échanges décentralisés sur Internet.
***
Ce problème méthodologique dans le modèle économique de la Hadopi est assez troublant. Même si la Hadopi pense que les échanges décentralisés sont devenus aujourd’hui minoritaires (ce qui est déjà contestable), elle ne peut pas ne pas les inclure dans son modèle, au moins à titre d’hypothèse, sinon celui-ci se coupe d’une partie des possibles et la simulation se transforme en pari aléatoire sur l’avenir. Par ailleurs, une omission aussi lourde fait franchement douter de la scientificité de la démarche. Depuis le départ, la Hadopi est partie sur un modèle de légalisation, décidé a priori. Et à présent, on voit bien que la méthodologie employée est développée de manière à conforter un résultat déjà posé à l’avance.
Tout ceci ne serait pas si grave si ce discours sur le basculement des échanges des formes centralisées et marchandes n’alimentait pas aussi au passage la volonté de durcir encore la répression contre "la contrefaçon commerciale". Or comme je l’ai dit au début de ce billet, on voit bien que l’État français va très certainement bientôt essayer de mettre en place un "SOPA à la française", qui aura pour but de cibler les intermédiaires techniques impliqués dans les transactions financières (régies publicitaires, systèmes de paiement en ligne, mais aussi moteurs, hébergeurs, etc) en allant piocher dans les suggestions de Mireille Imbert-Quaretta, membre elle-même de la Hadopi…
Voilà pourquoi il est temps d’en finir avec tout ce Storytelling autour de la Rémunération du partage à la Hadopi. Une vraie menace pour les libertés se profile à l’horizon et il faudra surveiller de près ce qui sortira du Ministère de la Culture avec la "loi sur la création".
On retire de tout ceci une impression d’épouvantable gâchis, car le rapport Lescure avait recommandé au Ministère de la Culture de conduire des études sur la légalisation du partage et si celui-ci avait pris ses responsabilités, il aurait pu mettre en place un vrai cadre de réflexion sur ces questions.
[Mise à jour du 08/09/2014] En réaction à la lecture de ce billet, Éric Walter affirme sur Twitter que les formes de partage décentralisé seront "bien prises en compte" par le modèle, au motif que la "consommation via intermédiaires" figurant dans le modèle économétrique "ne limite pas ces intermédiaires à une catégorie particulière". Hum… comment dire ? Quiconque fera une lecture attentive du rapport se rendra vite compte que c’est difficilement probable. En effet, les conséquences d’un glissement des pratiques, soit vers des formes de partage centralisés marchands, soit vers des formes de partage décentralisés non-marchands, sont tout à fait différentes. Elles ont notamment une incidence directe sur les montants de Rémunération Proportionnelle du Partage récoltés. D’un point de vue méthodologique, il était donc bien nécessaire de les distinguer dans le modèle économétrique, en faisant apparaître deux catégories séparées, sinon l’hypothèse que la Hadopi veut vérifier ne pourra tout simplement pas l’être. Cela devrait même, si la démarche se veut vraiment rigoureuse, constituer une des questions centrales de l’étude économétrique… Mais ne faisons pas la fine bouche, ce qui importe, c’est que la question des échanges non-marchands décentralisés soit bien prise en compte dans le modèle économétrique. Et même si c’est rajouté ex post, ce sera déjà ça !
Classé dans:Modèles économiques/Modèles juridiques Tagged: droit d'auteur, Hadopi, modèles économiques, partage, piratage, rémunération proportionnelle du partage, SOPA