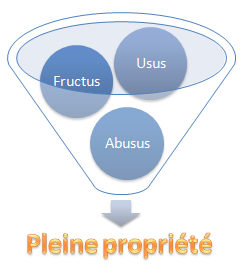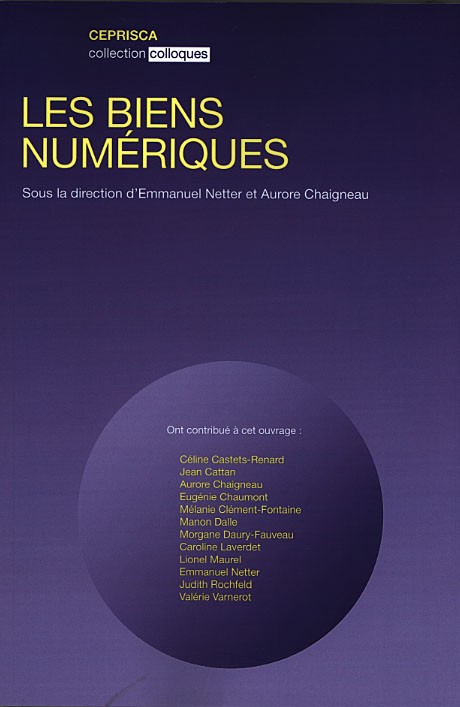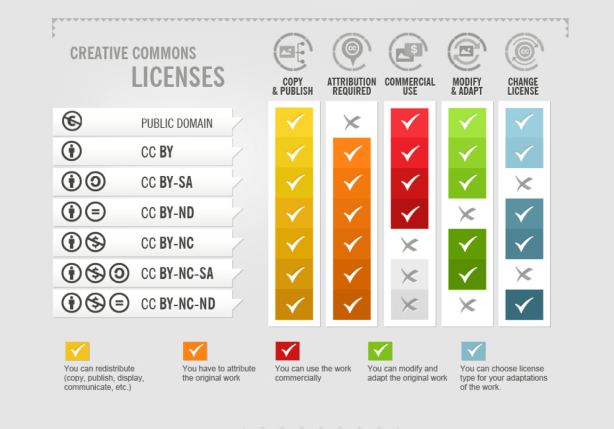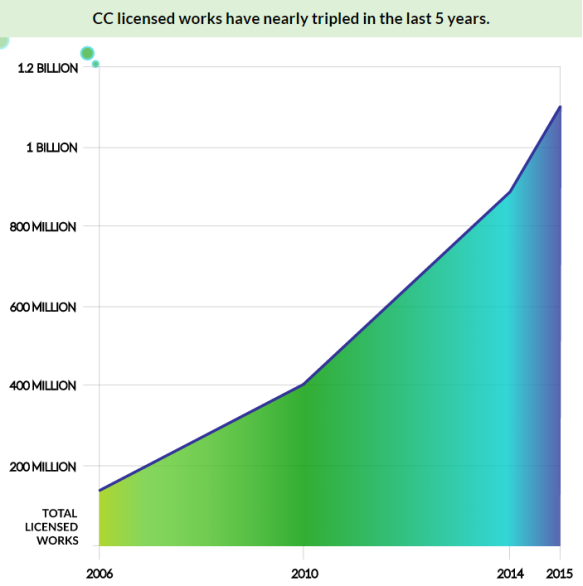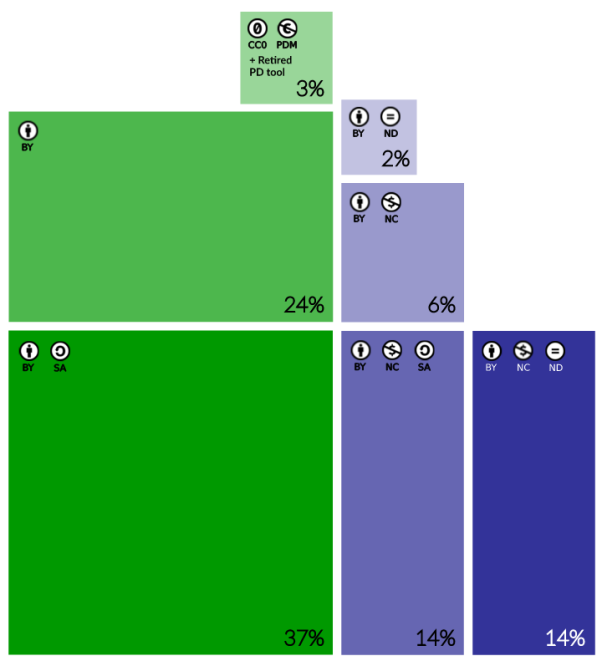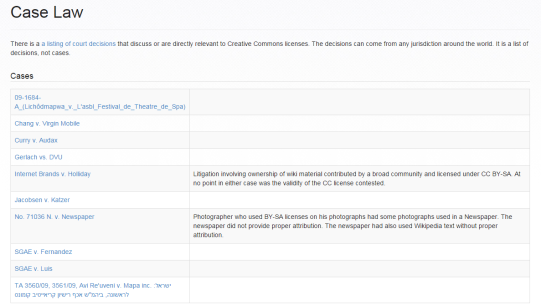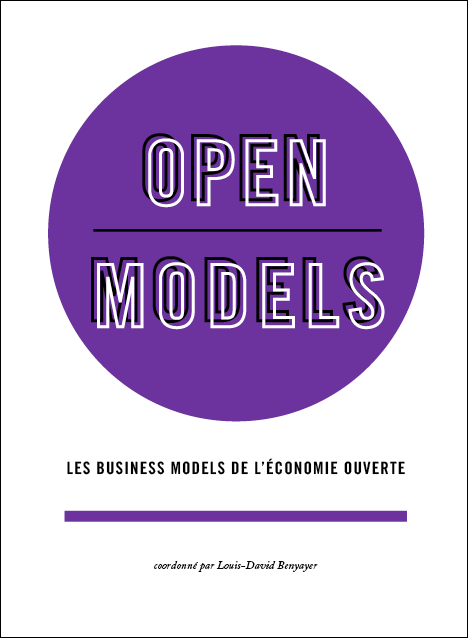Le PEB des thèses électroniques : un exemple de régression numérique (et comment en sortir)
vendredi 12 février 2016 à 19:02La numérisation des contenus devrait normalement faciliter les usages, en favorisant une meilleure circulation de la culture et du savoir. Or force est de constater que c’est loin d’être toujours le cas. On nous a vendu par exemple l’idée que les eBooks seraient des « livres augmentés », alors que comme j’ai déjà eu l’occasion de l’écrire, ils constituent trop souvent au contraire des « livres diminués » par rapport à leurs équivalents papier.
Il existe un autre objet pour lequel le passage en version numérique paraît constituer une régression plutôt qu’un progrès : ce sont les thèses de doctorat. En fin d’année dernière, un billet publié par Olivier Legendre sur le blog de la bibliothèque numérique de Clermont-Ferrand avait bien montré l’absurdité de la situation. Les doctorants sont traditionnellement tenus de déposer des exemplaires de leur thèse auprès de la bibliothèque de leur université afin qu’elle en assure la conservation, le signalement et la diffusion. Pendant des décennies, lorsqu’un usager d’une bibliothèque voulait accéder à une thèse conservée dans un autre établissement, il avait la possibilité de se la faire envoyer par le biais du service du PEB (Prêt entre Bibliothèques).

Or depuis un arrêté ministériel du 7 août 2006, le dépôt peut aussi avoir lieu sous forme électronique, et certains établissements ont même renoncé, pour des raisons de commodité évidentes, au dépôt sous forme papier. L’arrêté précise que lorsque le doctorant communique un fichier de sa thèse à la bibliothèque , il ne peut s’opposer, sauf pour des raisons de confidentialité reconnues par le jury de thèse, à ce qu’elle fasse l’objet d’un accès au sein de l’établissement de soutenance. Par contre, la mise en ligne du fichier sur Internet requiert l’autorisation explicite du doctorant, formalisée par un contrat signé au moment du dépôt.
Que se passe-t-il à présent si un doctorant a refusé la mise en ligne, mais qu’un usager d’un autre établissement demande à pouvoir consulter le fichier ? Voilà ce qu’Olivier Legendre répondait à cette question dans son billet :
En 2015, Pierre-Gilles s’adresse au service de prêt entre bibliothèques de Marseille. Ce service contacte celui de Paris, qui lui répond que la thèse n’est consultable que sur intranet. Et qui de ce fait, ne s’estime pas autorisé à l’envoyer par le PEB.
En 2015, Pierre-Gilles va devoir
prendre le TRAIN
pour aller CONSULTER
une thèse ÉLECTRONIQUE.
On est donc bien dans une situation absurde, où l’exemplaire papier de la thèse s’avère finalement plus facile à communiquer à distance que sa version numérique. Pourtant, on pourrait imaginer une solution bien plus logique, envisagée par Olivier Legendre dans son billet :
Le service de PEB de Paris va envoyer le fichier électronique à son homologue marseillais, comme il l’aurait fait d’une thèse imprimée ; à charge pour ce dernier d’offrir le fichier au lecteur dans ses locaux comme il l’aurait fait d’une thèse imprimée ; à charge pour Pierre-Gilles d’en faire bon usage, ce bon usage ne pouvant, du reste, exclure ni téléchargement, ni impression (ces mêmes droits qui s’appliquent dans l’université d’origine, tout simplement).
Le problème, c’est que même si cette solution paraît frappée du sceau du bon sens, elle soulève en l’état du droit plusieurs difficultés juridiques épineuses. Il est intéressant d’essayer de voir en quoi consiste le problème, pour comprendre ce qui provoque exactement cet effet de « régression numérique » à propos des thèses et essayer d’imaginer comment on pourrait éventuellement déverrouiller la situation.
L’implacable portée des droits exclusifs de l’auteur
L’arrêté de 2006 précise que l’autorisation de l’auteur de la thèse est nécessaire pour pouvoir diffuser celle-ci sur Internet (le texte parle exactement de « mise en ligne sur la Toile« ). Or le PEB ne constitue pas à proprement parler une diffusion sur le web, mais seulement une transmission du fichier à distance qui peut tout à fait s’opérer de manière sécurisée. Dès lors, l’arrêté ne prévoyant pas explicitement l’hypothèse du PEB, n’est-on pas en droit de faire prévaloir l’esprit du texte sur la lettre pour considérer que l’autorisation n’est requise que pour le cas particulier de la mise en ligne ?
Le problème, c’est que cette lecture se heurte d’emblée aux règles strictes prévues dans le Code de Propriété Intellectuelle concernant le formalisme des cession de droits et l’interprétation de la volonté des auteurs dans les contrats. En effet, l’article L. 131-3 indique que :
La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
La jurisprudence interprète ces dispositions comme exigeant que chaque usage d’une oeuvre fasse l’objet d’une autorisation explicite et précise dans les actes de cession ou de licence. Lorsqu’un flou subsiste dans un tel acte, il sera nécessairement interprété de manière restrictive par le juge, toujours dans un sens favorable à l’auteur. Cela signifie qu’un usage non explicitement prévu au contrat devra être réputé comme toujours interdit.
Or ce que l’on appelle un PEB pour d’une thèse électronique consiste en un acte de reproduction et de communication d’une oeuvre protégée. Ces actes doivent être autorisés en tant que tels par l’auteur pour pouvoir être effectués légalement. Certes, l’arrêté du 7 août 2006 (qui n’est pas une loi, mais un acte réglementaire) semble préciser que l’autorisation de l’auteur n’est requise que pour la mise en ligne sur Internet de la thèse.
Mais les dispositions du Code de propriété intellectuelle ont une valeur supérieure et elles demeurent actives en arrière-plan à ce texte. L’arrêté introduit une exception pour l’accès à la thèse électronique dans les emprises de l’établissement, mais il ne neutralise pas pour autant le droit exclusif des auteurs de thèses, qui continue à s’appliquer pour les actes liés à la fourniture à distance d’une thèse.
Pas de piste du côté des exceptions législatives
Dans le cas où on est confronté à un usage relevant d’un droit exclusif, on peut essayer de faire appel à une exception législative pour se dispenser de l’autorisation de l’auteur. Mais ici, aucune des exceptions prévues par le Code de propriété intellectuelle n’est mobilisable : que ce soit l’exception de copie privée, l’exception « conservation » ou l’exception pédagogique et de recherche qui ont des champs d’application différents. Cette dernière en particulier permet seulement l’utilisation d’extraits d’oeuvres à des fins d’illustration de la recherche et de l’enseignement. Des accords sectoriels signés entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et des sociétés de gestion collective prévoient également une série d’usages complémentaires, comme la diffusion d’oeuvres en classe ou durant des conférences, l’usage d’extraits dans des supports pédagogiques ou des sujets d’examen. Mais ces textes ne parlent à aucun moment de la communication à distance des thèses.
Le droit exclusif de l’auteur s’applique donc bien aux actes de reproduction et de communication impliqués dans le PEB de la thèse électronique. On pourrait cependant arguer que si le fichier est transmis à l’extérieur à une personne affiliée à l’Enseignement Supérieur, aucun préjudice n’est causé à l’auteur par rapport à un accès à la thèse sur l’intranet de l’établissement de soutenance. Le problème, c’est que l’application du droit d’auteur n’est pas conditionnée au fait de subir un préjudice. La loi dit bien qu’il s’agit d’un droit de propriété, « exclusif et opposable à tous« . S’il n’y a pas de préjudice, le titulaire de droits va être limité pour agir au civil et il ne pourra obtenir qu’une réparation symbolique. Mais cela ne l’empêche pas de demander au juge de faire cesser l’atteinte à ses droits, ni d’agir au pénal.
Si la thèse n’existe qu’en version électronique (ce qui sera de plus en plus le cas à l’avenir), il resterait peut-être l’expédient de l’imprimer en version papier et de l’envoyer par la poste au demandeur. Mais même là, le droit d’auteur fait barrage. Car l’impression de la thèse par les soins de la bibliothèque universitaire à partir du fichier n’est pas assimilable à une copie privée, étant donné que celle-ci implique que celui qui réalise la copie et celui qui utilise la reproduction subséquente soit la même personne, à l’exclusion des « utilisations collectives« .
Demander communication de la thèse en tant que document administratif ?
Si les choses s’avèrent relativement bloquées du côté des mécanismes du droit d’auteur, on pourrait envisager de changer le fusil d’épaule en considérant que la thèse n’est pas seulement une oeuvre de l’esprit, mais aussi un document administratif, nécessaire à l’obtention du doctorat. Or la loi française consacre au bénéfice des citoyens un droit d’accès aux documents administratifs, opposable aux administrations sous le contrôle de la CADA. De surcroît les conditions d’exercice de ce droit d’accès prévoient bien qu’il peut être demandé à l’administration de communiquer par mail le document, s’il existe sous forme électronique. En refusant de communiquer une thèse électronique, la bibliothèque universitaire ne peut-elle pas être accusée de se mettre en faute pour « non-diffusion d’informations publiques » ?
Le problème ici, c’est que la thèse a bien une « double nature », à la fois oeuvre et document. Or la loi a prévu cette hypothèse et elle fait prévaloir dans ce cas le droit d’auteur sur le droit d’accès. La loi du 17 juillet 1978 indique à son article 10 que :
ne sont pas considérées comme des informations publiques […] les informations contenues dans des documents […] sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Or les doctorants sont bien considérés comme des tiers par rapport à l’administration et ils conservent un droit d’auteur plein et entier sur thèse. Dès lors, la nature d’oeuvre de l’esprit de la thèse l’emporte sur celle de document administratif et il n’est pas possible d’invoquer le droit d’accès pour en exiger la communication à distance.
Faire valoir le droit à l’information et la liberté de la recherche ?
Est-ce à dire que toutes les portes sont pour autant fermées pour le PEB des thèses électroniques ? Peut-être pas. Si l’on prend un peu de hauteur pour se placer au niveau du droit de l’Union européenne, peut-être qu’une piste se dessine actuellement autour de l’invocation du droit à l’information et de la liberté de la recherche.
En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme développe depuis plusieurs années une jurisprudence intéressante, qui cherche à définir un meilleur équilibre entre le droit d’auteur et les libertés fondamentales consacrées dans la Convention européenne des droits de l’Homme. J’ai déjà eu l’occasion d’en parler le mois dernier dans S.I.Lex à propos du droit au remix. En l’absence même d’une exception législative, la CEDH demande à ce que les juges opèrent un « juste équilibre » entre le respect du droit d’auteur et l’exercice des libertés fondamentales. La Cour de Cassation française semble progressivement se ranger à cette approche, en demandant aux juges inférieurs de mettre en balance le droit d’auteur et la liberté d’expression, y compris en dehors des cas couverts par une exception législative.
Concernant le PEB de thèses électroniques, nous avons vu qu’il n’existe actuellement pas d’exception dans la loi française que l’on puisse invoquer à l’appui de cet usage. Mais il paraît possible de faire valoir que la transmission du fichier à distance est nécessaire pour l’exercice du droit à l’information et la liberté de la recherche scientifique. Si cette communication est effectuée de manière sécurisée et si le bénéfice de cette faculté est réservé aux mêmes catégories d’usagers qui auraient pu consulter la thèse électronique sur place, il ne semble pas y avoir d’atteinte disproportionnée au droit d’auteur, mais au contraire un « juste équilibre » avec d’autres droits.
Ce type de raisonnement a déjà commencé à voir une réalisation concrète dans le champ de la recherche scientifique à propos d’une affaire ayant donné lieu à un jugement au Pays-Bas à la fin de l’année dernière. Un litige a en effet éclaté à propos du Journal d’Anne Frank entre le Fonds Anne Frank, détentrice des droits sur l’oeuvre, et la Maison Anne Frank qui conserve de son côté les manuscrits originaux. Cette dernière a réalisé une reproduction numérique de ces documents et l’a transmise à une équipe de chercheurs hollandais, notamment afin qu’ils puissent l’encoder en TEI pour procéder à des analyses du texte. Or saisi de cette affaire, un tribunal hollandais a considéré, en visant la Convention européenne des droits de l’Homme, que même en l’absence d’exception dans la loi nationale couvrant ce type d’actes, ils ne constituaient pas une contrefaçon dans la mesure où ils étaient nécessaires au libre exercice de la recherche et que les fichiers n’étaient pas mis en ligne sur Internet par les chercheurs.
Un raisonnement similaire pourrait très bien être appliqué au cas du PEB des thèses électroniques. Le problème, c’est qu’il est par définition difficile d’appréhender ce que l’équilibre entre le droit d’auteur et les libertés fondamentales justifie exactement. Seuls les juges pourront le déterminer avec certitude au fil de la jurisprudence. Il est donc encore trop tôt pour être certain que le PEB de thèses électroniques sera couvert par ce raisonnement, sachant que les premières affaires s’appuyant sur cette nouvelle démarche initiée par la CEHD ne sont pas encore allées à leur terme en France.
Que faire pour débloquer la situation ?
Si on veut éviter que pour les thèses, le numérique ne conduise à une régression, sur quels leviers peut-on agir ?
- Le plus évident est d’agir au niveau contractuel en incitant au maximum les doctorants à autoriser la diffusion en ligne de leur thèse sur Internet, comme le permet l’arrêté de 2006. La question du PEB ne se pose à vrai dire plus pour une thèse accessible en ligne et après tout, le PEB n’est qu’un « palliatif » à l’absence de diffusion sur Internet en Open Access. Néanmoins, il est aussi possible d’insérer dans les contrats signés par les doctorants au moment du dépôt des thèses une clause autorisant explicitement le PEB de la thèse sous forme électronique, à charge pour le doctorant de l’accepter. Le droit exclusif de l’auteur s’applique, mais il faut toujours se rappeler qu’il s’agit aussi bien d’un droit d’autoriser que d’interdire. Tout peut se régler par la voie contractuelle, mais cela représente néanmoins un gros travail de pédagogie pour faire évoluer des mentalités parfois encore assez frileuses.
- L’arrêté de 2006 pourrait ensuite être modifié pour indiquer que de la même manière que le doctorant ne peut pas s’opposer à la diffusion de sa thèse au sein de l’établissement de soutenance, il ne peut pas non plus s’opposer à sa transmission à distance à l’usager d’un autre établissement, à condition que celle-ci s’effectue de manière sécurisée. Cette hypothèse d’une modification de l’arrêté est sans doute la manière la plus simple de faire évoluer le droit dans le sens des usages, puisque qu’elle ne nécessite qu’une décision ministérielle et pas un passager au Parlement.
- On pourrait aussi envisager de modifier l’exception pédagogique et de recherche afin qu’elle couvre les actes de reproduction et de communication effectués par des bibliothécaires à la demande d’un usager pour la transmission d’une thèse électronique. Dans plusieurs pays d’Europe, et notamment en Angleterre, une exception au droit d’auteur permet aux bibliothèques de reproduire et transmettre des oeuvres à la demande de leurs usagers, à des fins de recherche et d’études privées. En général, la copie ne peut alors être intégrale, mais s’agissant du cas particulier des thèses, on pourrait imaginer que cela soit permis. Il est d’ailleurs dommage que cette question n’ait pas été traitée dans le cadre de la loi numérique en cours d’examen au Parlement, qui abordent plusieurs sujets en lien avec l’IST. Cela aurait pu être aussi l’occasion, au-delà des thèses, d’envisager un mécanisme législatif général pour la fourniture à distance de documents, qui peine à se sortir de l’ornière en France depuis des années.
- La dernière option consiste à considérer que même si l’usage ne respecte pas à la lettre le droit en vigueur, il appartient aux bibliothèques de prendre leurs responsabilités et de mettre quand même en oeuvre un PEB des thèses électroniques sur une base pragmatique et raisonnable. Après tout, plusieurs usages en bibliothèque s’opèrent toujours aujourd’hui sans aucune base légale (le prêt de CD, la mise à disposition de jeux vidéo ou d’applications pour tablettes, etc.). S’il avait fallu attendre que la loi change, les bibliothèques auraient été contraintes à renoncer à l’exercice d’une partie importante de leurs missions en faveur de l’accès à la culture et à la connaissance. Par ailleurs, la jurisprudence de la CEDH sur l’équilibre entre droit d’auteur et libertés fondamentales que j’ai signalée plus haut offre aujourd’hui une base pour agir en l’absence de mécanisme légal au niveau national. Certes, cette piste reste encore fragile, mais l’immobilisme du législateur étant ce qu’il est en France en matière de réforme du droit d’auteur, ce sera peut-être la seule voie pour sortir de l’impasse.
***
En 2000, l’IFLA avait produit une très belle déclaration à propos du droit d’auteur dans l’environnement numérique, qui proclamait ce principe : « Digital Is Not Different », au sens où les droits et libertés qui existaient dans le monde analogique ne devaient pas être compromis avec le passage au numérique. 15 ans plus tard, l’exemple des thèses électroniques montre que le risque de la régression est loin d’avoir été conjuré et il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau légal et réglementaire pour arriver ne serait-ce qu’à une simple équivalence entre le papier et le numérique.
PS : ce billet a été très largement nourri par des échanges de courriels avec Olivier Legendre et David Aymonin. Merci à eux d’avoir partagé avec moi leurs réflexions et leurs expériences en la matière.
Classé dans:Penser le droit d'auteur autrement ... Tagged: Bibliothèques, document administratif, droit d'auteur, exception pédagogique, exceptions, PEB, recherche, thèse
![]()