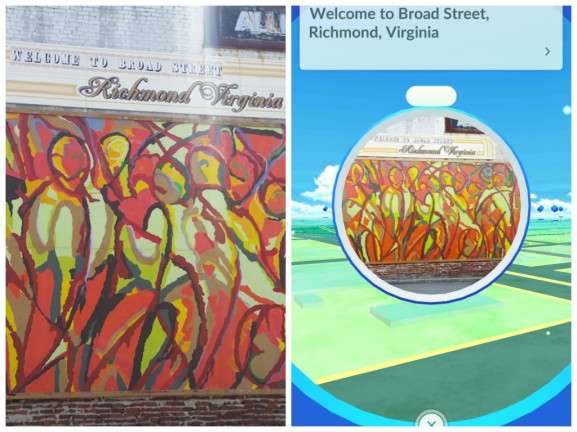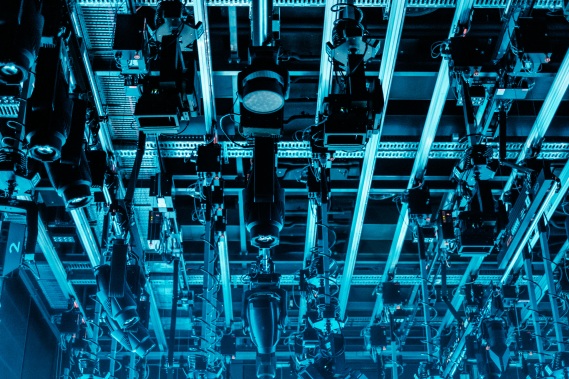Open Content dans les musées : un retour d’expérience du Getty Museum
vendredi 19 août 2016 à 13:42Le Getty Museum constitue un grand établissement culturel américain dédié aux Beaux Arts qui a choisi, il y a trois, de rejoindre le mouvement Open GLAM pour embrasser une politique d’Open Content. Cela signifie que l’institution a décidé de rendre librement réutilisables les reproductions numériques des oeuvres produites à partir de ses collections, sans autre contrainte que l’indication de la source. Initié avec 4500 oeuvres, le programme en compte aujourd’hui plus de 100 000 , avec des images en haute résolution correspondant à des peintures, des dessins, des manuscrits ou des photographies appartenant au domaine public.

Pour célébrer les trois ans du lancement de cette politique, le Getty a publié sur son blog un billet qui dresse un premier bilan et qui revient sur les difficultés ayant dû être surmontées pour ouvrir les contenus issus de deux projets. On se rend compte à la lecture de cet article que la politique d’Open Content ne concerne plus seulement au Getty les collections numérisées, mais aussi des publications numériques, des ressources pédagogiques, des jeux de données ou des logiciels. Comme ce billet a été placé sous licence Creative Commons BY (CC-BY), je peux vous en proposer ci-dessous une traduction en français.
J’ai trouvé cet article intéressant, car il témoigne de l’acquisition de nouvelles compétences que l’établissement a dû intégrer pour développer ces démarches innovantes d’Open Content. Le contraste est aussi hélas fort avec les établissements culturels français, qui sont toujours dans leur grande majorité retranchés derrière des pratiques de réservation des droits, empêchant la libre réutilisation des contenus qu’ils produisent.
La situation ne s’est hélas guère arrangée d’un point de vue légal. La loi « République Numérique » et la loi Valter vont poser un cadre général, qui va imposer à une grande partie des administrations publiques de passer à une politique d’Open Data par défaut. Mais les institutions culturelles vont conserver un régime dérogatoire, leur permettant de continuer à lever des redevances pour la réutilisation du produit de la numérisation de leurs collections. C’est dire que le copyfraud, à savoir la création de nouvelles couches de droits neutralisant les libertés conférées par le domaine public, va littéralement être légalisé en France…
Les portails récemment mis en ligne par de grandes institutions culturelles, comme celui de la RMN ou celui des musées de la Ville de Paris, témoignent encore d’une approche extrêmement fermée, avec des images certes accessibles en ligne gratuitement, mais en faible résolution et marquées d’un copyright entravant les réutilisations. On est aux antipodes d’une politique d’Open Content innovante comme celle du Getty.

Pourtant malgré cette stagnation législative, les démarches d’ouverture restent possibles en France. Il suffit aux institutions culturelles de le décider, et certaines le font déjà, en optant pour des licences ouvertes pour la diffusion des contenus qu’elles produisent. Espérons que l’exemple du Getty puisse inspirer davantage d’entre elles.
L’Open Content au Getty : Trois ans après, les leçons que nous avons apprises
Cette semaine, nous célébrons les trois ans du lancement de l’Open Content Program du Getty, qui a permis de mettre à disposition 4600 images en haute résolution issues des collections du Getty Museum et de l’Institut de Recherche du Getty, librement réutilisables, modifiables et publiables par quiconque à n’importe quelle fin. Dans l’annonce de ce lancement, notre président Jim Cuno laissait entendre que davantage de contenus seraient mis à disposition en libre réutilisation dans les mois suivants, y compris des publications numériques et d’autres ressources documentaires.
Et c’est ce qui s’est produit : depuis 2013, le Getty a libéré plus de 100 000 images supplémentaires dans le cadre de l’Open Content Program, et nous utilisons de plus en plus les licences ouvertes pour les contenus développés par le Getty : des sélections de publications numériques, des inventaires d’archives de l’Institut de Recherche, les données associées à la collection en ligne du Getty Museum, des ressources pédagogiques de l’Institut de Conservation du Getty, et jusqu’au blog que vous êtes en train de lire en ce moment. Ce faisant, notre priorité en développant des ressources sous licence ouverte a été de rendre le travail du Getty aussi largement disponible et réutilisable que possible, tout en maintenant simplement l’obligation de citer la source.
L’accès en ligne aux ressources culturelles aide à développer la compréhension des arts et se trouve au coeur de notre mission et de nos devoirs envers les communautés professionnelles au service desquelles nous travaillons. Mais l’Open Access et l’usage des licences libres représentent un changement significatif dans la manière sont le Getty conçoit, produit et diffuse des contenus, ainsi que dans la gestion des droits associés. Nous nous sommes rendus compte qu’en la matière, il est souvent plus facile de dire que de faire, particulièrement pour des projets qui ont été conçus avant que le Getty n’embrasse une politique d’Open Content.
Pour le troisième anniversaire du lancement de notre Open Content Program, nous partageons quelques unes des leçons que nous avons apprises en cours de route, en nous concentrant sur deux projets récents de l’Institut de Recherche qui ont nécessité une collaboration étroite entre l’équipe juridique du Getty (Mikka) et le groupe sur le numérique et l’histoire de l’art de l’Institut de Recherche (Nathaniel et Marissa).
Creative Commons: Pietro Mellini’s Inventory in Verse, 1681
L’inventaire en vers de Pietro Mellini (1681) (le Mellini en abrégé) est une publication en ligne incluant un facsimilé de l’inventaire écrit en vers par Pietro Mellini au 17ème siècle à Rome pour décrire la collection d’art de sa famille, des essais rédigés par des chercheurs pour resituer le document dans son contexte et une liste partiellement illustrée des oeuvres d’art figurant dans l’inventaire. Le Mellini est à présent disponible sous la licence Creative Commons Paternité 4.0 (CC-BY).
Nous avons décidé de faire passer le Mellini sous CC-BY seulement après qu’il ait été publié. Après avoir vu une présentation du projet par son principal instigateur Murtha Baca, Mikka regarda quel était le statut juridique du projet et s’il était possible de le publier sous une licence ouverte. Il est vite apparu qu’il s’agissait d’un candidat idéal pour plusieurs raisons :
- L’objet lui-même (l’inventaire de Mellini) faisait partie des collections de l’Institut de Recherche ; il n’y avait donc pas de permission à demander à un prêteur ;
- L’objet appartenait au domaine public en raison de son ancienneté et aucune restriction de droit d’auteur ne s’appliquait, ni sur l’objet lui-même, ni sur ses reproductions ;
- La traduction et les textes d’accompagnement ont été réalisés par des employés du Getty ou ont été sollicités par l’établissement comme des travaux de commande, ce qui lui garantissait le bénéfice des droits sur tous les textes ;
- Les oeuvres d’art reproduites étaient aussi dans le domaine public et dans la plupart des cas, des images de référence librement réutilisables pouvaient être trouvées sur Wikimedia Commons.
(Note : la Fondation Wikimedia, comme le Getty, estime que les reproductions fidèles en deux dimensions d’oeuvres du domaine public appartiennent elles-mêmes au domaine public, en raison du défaut d’originalité requis pour pouvoir revendiquer la protection du droit d’auteur. Voir Bridgeman Art Library v. Corel Corp., 36 F. Supp. 2d 191, 196–97 (S.D.N.Y. 1999); voir aussi Feist Publ’ns v. Rural Tel. Serv. Co., Inc., 499 U.S. 340, 359–60 (1991) – « l’originalité, non les simples efforts (sweat of the brow), constitue la pierre angulaire de la protection du droit d’auteur… »)
En travaillant ensemble, nous nous sommes assurés qu’une licence CC-BY pouvait être appliquée à la vaste majorité des contenus du Mellini. Le seul point problématique résidait dans les quelques images provenant de sources extérieures, pour lesquelles des autorisations avaient été demandées et obtenues avant que la décision de placer le Mellini sous licence ouverte ne soit prise. En d’autres termes, les permissions originales couvraient seulement la publication en ligne, sans mentionner la licence CC-BY, et dès lors, nous ne disposions pas contractuellement de la possibilité de placer ces contenus sous licence ouverte.
Le défi technique et juridique a alors consisté à trouver un moyen d’appliquer la licence CC-BY aux contenus produits par le Getty, tout en excluant les contenus extérieurs sur lesquels des tiers continuaient à se réserver les droits. Cela nécessita de produire une mention écrite suffisamment claire dans les notices du projet à destination des lecteurs humains, et d’ajouter une mention lisible par les machines (par le biais de marqueurs HTML) pour indiquer également le statut juridique de chaque élément aux crawlers web.
GNU : l’espace de travail des chercheurs du Getty
L’espace de travail des chercheurs du Getty (Getty Scholars’ Workshop) est un environnement numérique collaboratif de recherche à destination des historiens de l’art. Dès sa conception, il a été pensé comme un outil numérique open source qui devait gratuitement être mis à disposition de la communauté scientifique (ou n’importe qui d’autres qui voudrait l’utiliser !). Il a été développé sous Drupal, un CMS open source utilisé principalement pour développer des sites web. Drupal bénéficie d’une communauté active de programmeurs qui contribuent au CMS en produisant des modules.
Même si l’intention de base a toujours été de mettre à disposition le code source de cet espace de travail sous licence libre, la plus grande partie a été développée avant que le Getty n’adopte une politique d’Open Access, et avant que le Getty ait intégré les bonnes pratiques en matière de développement en interne et de publication en open source des logiciels. Ainsi comme avec le Mellini (qui par coïncidence a utilisé une des premières versions de l’espace de travail des chercheurs du Getty durant sa phase de recherche), la décision d’opter pour des licences ouvertes fut simple à prendre, mais plus difficile à mettre en oeuvre (notamment pour déterminer quelle licence nous devions utiliser).
L’espace de travail des chercheurs du Getty a été développé avec la version 7 de Drupal et il utilise une combinaison de modules modifiés ou non, issus de la communauté Drupal. Tous les modules produits par la communauté Drupal sont publiés sous GNU General Public Licence, Version 2 ou suivante. Cependant, l’espace de travail des chercheurs du Getty utilise aussi un certain nombre de modules open source qui n’ont pas été produits par la communauté Drupal et qui, de ce fait, ont été publiés selon des licences que leurs auteurs estimaient appropriées.
De plus, plusieurs des 28 modules développés par l’Institut de Recherche contenaient des lignes de code empruntées à des tiers, une pratique commune dans la communauté open source. Cela signifie que de multiples licences extérieures s’appliquaient même aux modules développés par ou pour l’Institut de Recherche, au-delà de la seule GNU GPL applicable aux composants Drupal. Et nous avions besoin d’une seule licence pour l’ensemble…
Pour choisir la bonne licence, il s’agissait d’identifier les licences open source qui correspondaient aux priorités du Getty (rendre le travail disponible le plus largement possible et le plus facilement réutilisable, tout en maintenant l’obligation de citer la source), et ainsi déterminer quelles licences seraient compatibles avec les différentes obligations contractuelles s’appliquant aux parties incorporées dans le logiciel. Pour accomplir cela, nous avons eu besoin d’un consultant extérieur afin d’analyser les termes des licences portant sur les quelques 5000 fichiers stockés dans 121 répertoires qui composaient le code source. Et tout cela dut être effectué dans un laps de temps très court pour rester en phase les échéances fixées pour la réalisation du projet par les financeurs du projet. Finalement, après une analyse approfondie, l’espace de travail des chercheurs du Getty fut publié sous la GNU General Public Licence, version 3.
A retenir
Les défis liés à l’Open Access ou à l’Open Source sont les mêmes que ceux qui s’attachent à tout changement de cadre ou de paradigme : parce que c’est nouveau, la plupart d’entre nous doivent apprendre en avançant. Travailler sur le Mellini ou sur l’espace de travail des chercheurs du Getty nous a apporté quelques enseignements.
Tout d’abord, il est important pour l’institution de comprendre clairement – et d’être capable d’expliciter – pourquoi elle attache de l’importance aux licences ouvertes, et d’être en mesure de faire la distinction entre les projets qui peuvent et doivent être publiés sous licence ouverte et ceux qui ne peuvent pas ou ne doivent pas l’être.
Deuxièmement, il est beaucoup plus facile de construire un projet très le départ en open source plutôt que d’ouvrir un projet après coup. Quand l’Open Access est dès l’origine un des objectifs du projet, cela aide à prendre les décisions, en particulier celles liées aux contrats avec les collaborateurs et les consultants, ainsi que dans le choix des images et du code pour les logiciels. Troisièmement, la question des licences applicables aux logiciels peut s’avérer extrêmement complexe, spécialement quand le logiciel est construit avec des morceaux de code préexistant (ce qui facilite les choses durant le développement, mais peut compliquer la publication).
La bonne nouvelle, c’est qu’incorporer un élément de contenu en droits réservés n’empêche pas forcément le reste du projet d’être publié sous licence ouverte. Selon les termes des licences Creative Commons, elles s’appliquent aux « Contenus licenciés » et ces contenus peuvent être définis de manière à inclure seulement les éléments appropriés d’un projet. Cependant, dans la mesure où cet univers des licences ouvertes, et spécifiquement la manière dont s’en emparent le secteur des bibliothèques, musées et archives, est encore relativement nouveau, nous n’avons pas encore de précédents et d’exemples clairs sur lesquels nous appuyer pour le choix des licences, en particulier pour rendre compréhensible les textes destinés à être lus par des humains et pour s’assurer de la précision des textes lisibles par les machines. Pour le Mellini et l’espace de travail des chercheurs du Getty, nous avons fait de notre mieux en accord avec les objectifs en matière d’Open Access du Getty. Nous souhaitons voir et apprendre de ce que d’autres ont pu faire et continuer ainsi à contribuer au développement des ressources culturelles libres.
Classé dans:Bibliothèques, musées et autres établissements culturels, Domaine public, patrimoine commun Tagged: Creative Commons, Domaine public, musées, Numérisation, open content, Open Source