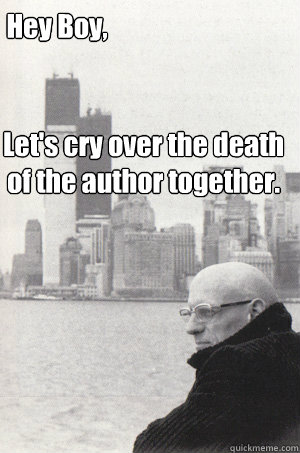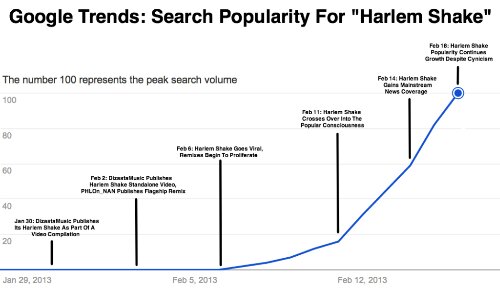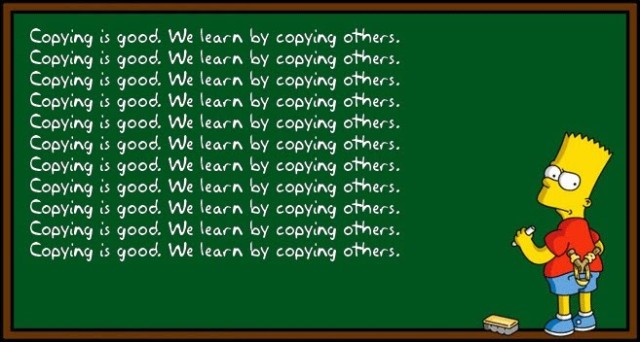Le mirage de l’offre "légale" et ce qu’il nous coûte
dimanche 12 mai 2013 à 20:37Après plus de neuf mois de travail, la mission Lescure rendra donc son rapport demain. On sait déjà que les 75 propositions qu’il comporte ne contiendront rien de "fondamentalement révolutionnaire". D’après les déclarations de Pierre Lescure, il faut comprendre que la mission ne préconisera pas de légalisation des échanges non marchands, pour s’en tenir à une optique de répression de ces pratiques (même si Hadopi disparaît et que la coupure de l’accès Internet se transforme en amende), ainsi qu’à une promotion de "l’offre légale" de contenus.
Pour patienter, avant de pouvoir plonger dans le rapport Lescure demain, je vous soumets quelques réflexions critiques sur le concept "d’offre légale", que j’avais initialement publiées sur les Eclats de S.I.Lex dans une forme moins étoffée.
Il y a un autre rapport qui est sorti il y a quelques semaines et qui mérite d’être lu attentivement avant d’examiner les propositions de la mission Lescure. La mission d’information sur les conditions d’emploi dans les milieux artistiques a en effet remis fin avril un rapport parlementaire qui contient une critique assez radicale du concept même "d’offre légale". Cette mission indique que l’offre légale est selon elle "non-viable" au vu des faibles revenus dégagés par les solutions expérimentées jusqu’à présent. Tirant les conclusions de cet échec, le rapport préconise la mise en place d’une licence globale, comme piste de rémunération pour la création.
La mission Lescure de son côté a balayé les solutions de type licence globale ou contribution créative d’un revers de main :
Une licence globale ou une contribution créative fait l’objet d’un rejet assez général, à quelques exceptions près" était-il précisé. Le sort de la licence globale semble donc d’ores et déjà scellé, surtout que la mission ajoute que cela reviendrait à déconnecter paiement et usage, ce qui est considéré comme "inefficace économiquement" mais aussi "injuste socialement".
Ce "rejet assez général" doit être nuancé, car la légalisation de certains échanges non marchands couplée à des solutions de financement de type licence globale ou contribution créative, a été soutenue devant la mission Lescure par SavoirsCom1, mais aussi par des titulaires de droits, comme les interprètes de la SPEDIDAM ou les photographes de l’UPP.
On rejette ces formes de financement mutualisé de la création, au motif qu’elles seraient "inefficaces économiquement". Mais le concept d’offre légale, non content de n’avoir pas permis de trouver une solution à la question de la rémunération de la création, s’est jusqu’à présent avéré dangereux, car il a conduit au renfoncement de nouveaux intermédiaires, comme Apple ou Amazon, dont la croissance incontrôlée se retourne à présent contre les filières culturelles.
Ces entreprises ont en effet bâti leurs empires sur l’emploi de DRM ou de systèmes d’intégration verticale, qui sont la contrepartie quasi mécanique du concept "d’offre légale". Présentés comme des dispositifs permettant de lutter contre le piratage, ces moyens de contrôle des contenus ont surtout eu pour but de renforcer l’emprise de ces géants. L’écosystème d’Apple est savamment verrouillé, tout comme celui d’Amazon et les "jardins fermés" qu’ils ont mis en place se sont avérés de redoutables pièges pour tous les autres acteurs de l’écosystème de la création.

Par ailleurs, toute forme d’offre légale tend à se transformer au fil du temps en une "licence globale privée", comme on le voit avec les formules d’abonnement illimité financées par de la publicité. Voyez par exemple cette excellente analyse par Philippe Axel :
L’abonnement illimité est une forme de licence globale, mise en place par les acteurs les plus puissants du marché, à leur seul profit, et dont très peu de responsables de cette filière, très étrangement, ne contestent les modes de redistribution des recettes en fonction des usages aux créateurs, alors qu’ils expliquent par ailleurs que ce serait impossible à accomplir dans le cadre d’une contribution globale dans l’abonnement Internet. Ce modèle va de pair avec une logique de marketing ciblé et donc d’espionnage à grande échelle de nos moeurs culturelles. Et il va de pair aussi, avec l’interdiction des échanges non marchands ; et donc une surveillance et une répression de ces usages sans quoi rien ne sera possible, que ce soit par une Hadopi ou directement par le juge.
Une licence globale "publique", décidée et organisée par le législateur, serait infiniment préférable à ces licences globales "déguisées" qui se cachent derrière certaines offres légales. Le modèle de la contribution créative, qui est défendu notamment par La Quadrature du Net, a affiné les propositions de la licence globale et gommé plusieurs des risques possibles de dérives. En prenant en compte la création dans son ensemble, jusque dans les productions des amateurs qui foisonnent sur la Toile, elle constitue une solution bien mieux adaptée aux évolutions induites par le numérique, justement parce qu’elle ne s’appuie pas sur la distinction entre le légal et l’illégal :
Ces propositions reposent sur la reconnaissance de droits culturels fondamentaux des individus et – attentives aux fonctions éditoriales à valeur ajoutée – prennent en compte les vrais défis de l’ère numérique : ceux de la multiplicité des contributeurs et des œuvres d’intérêt.
Pierre Lescure s’est fendu la semaine dernière d’une sortie dans laquelle il semble dire que tout modèle alternatif à l’offre "légale" revient à prôner un accès gratuit aux contenus culturels :
"Il faut que l’accès soit facile, possible, pour tous. Mais la gratuité absolue est contre nature", assure Pierre Lescure. "Plus on va dans la rareté, dans le service rendu, dans la délivrance de quelque chose qui a représenté un travail et qui ne trouve pas son pareil ailleurs, plus cela a un coût. On ne mange pas gratuitement au restaurant."
Mais un modèle comme celui de la contribution créative n’est justement pas un modèle de gratuité absolue, puisqu’il implique que les internautes paient un surcoût mensuel à leur connexion Internet pour contribuer au financement de la création. J’avais d’ailleurs eu l’occasion dans un billet précédent de critiquer l’idée de gratuité :
Le système de la contribution créative consacre une liberté d’échanger la culture et permet de récompenser les créateurs, en fonction du nombre de partages de leurs oeuvres, en leur reversant une part des sommes collectées à partir du surcoût à l’abonnement Internet. L’échange est alors libre tant qu’il s’effectue dans un cadre non commercial, mais même s’il n’est pas payant à l’acte, il n’est pas gratuit, puisque l’internaute doit s’acquitter de ce prélèvement mensuel.
Vous pourriez préférer, générations futures, continuer à accéder illégalement aux oeuvres, sans avoir rien à payer pour cela. Mais vous devez prendre en considération que cette gratuité a un coût, pour chacun de vous et pour la société toute entière.
Car pour lutter contre le partage des oeuvres, le législateur s’est engagé dans une spirale répressive, qui augmente sans cesse le niveau de la violence d’Etat et fait peser une grave menace sur nos libertés et sur l’intégrité d’Internet [...]
Cette fuite en avant du droit et ces agressions continuelles contre les libertés sont le prix à payer de la gratuité, pour nous et pour les générations futures.
Si l’on veut que le partage devienne un droit reconnu et consacré par la loi, alors il faut être prêt à en payer le prix, qui est celui de la contribution créative. Pour les individus, c’est une somme modeste de quelques euros par mois ; pour les créateurs, c’est une nouvelle manne de plusieurs centaines de millions par an. Pour la société toute entière, c’est le prix d’une paix retrouvée.
Les projections faites par Philippe Aigrain montrent qu’une contribution créative de l’ordre de 5 euros par mois pourrait générer plus d’un milliard d’euros de recettes par an. Depuis maintenant plus de 7 ans (débat sur la DADVSI) que l’on débat en France de l’introduction des financements mutualisés, cela signifie que les filières culturelles sont passées à côté d’environ 7 milliards de revenus. Quelle mystérieuse "offre légale" aurait permis d’atteindre de tels montants ? Et quel est le prix pour la société de la violence légale qu’il aura fallu déployer au nom de ce concept brumeux ?
Ajoutons de surcroît que les titulaires de droits eux-mêmes commencent à se détourner du concept d’offre légale, dès lors qu’un acteur s’avère capable de monétiser les échanges illégaux. C’est le cas par exemple de Google qui parvient à générer des revenus à partir de Youtube et à offrir un système de filtrage aux titulaires de droits (ContentID), par lequel ils acceptent de laisser leurs contenus circuler sur la plateforme, en échange d’une redistribution des recettes publicitaires. Il ne s’agit rien de moins que d’une licence globale privée et la SACEM, par exemple, approuve ce dispositif qui n’a plus rien à voir en réalité avec une "offre légale".
"L’offre légale" en réalité est un mirage, dont la fonction première n’est pas économique. Elle a toujours échoué à dégager une rémunération satisfaisante pour les créateurs. Les véritables pistes de financement qui s’ouvrent aujourd’hui, notamment dans le secteur de la musique, sont d’une toute autre nature.
La fonction réelle du concept "d’offre légale" est d’ordre symbolique et il faut aller la chercher en creux. Le label PUR d’Hadopi, par exemple, dérisoire tentative d’étiquetage d’Internet, sert surtout à taxer d’imPUR tout ce qui ne porte pas cette marque. Parler d’offre "légale" sert en définitive à jeter l’opprobre et à rejeter dans l’illégalité des pratiques de partage que la société elle-même ne condamne plus.
Extrait de la dernière étude qualitative du M@rsouin :
« Si le téléchargement est bel et bien perçu comme illégal, il n’y a pourtant pas d’identification de l’acte comme infraction – activité criminelle, vol, hors la loi -, car il n’est pas étiqueté comme déviant par l’entourage ou les proches ou dans un contexte social plus vaste. »
On ne pourra pas repenser en profondeur la question du droit d"auteur et du financement de la création tant qu’on n’aura renoncé au mirage de l’offre légale.
Classé dans:Modèles économiques/Modèles juridiques Tagged: exception culturelle, Hadopi, licence globale, Mission Lescure, offre légale