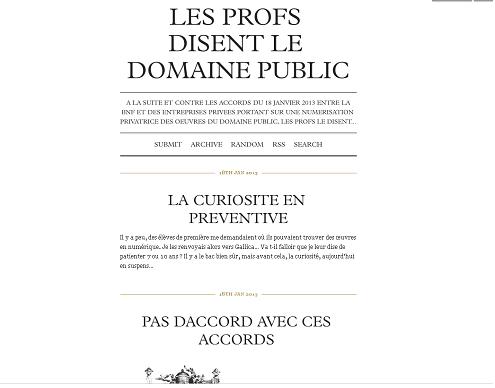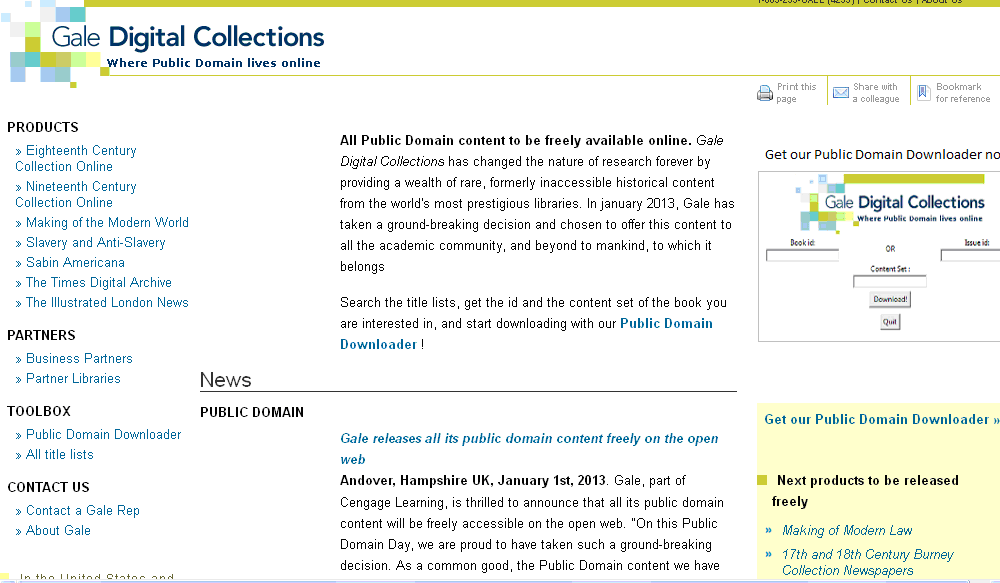Privatisation, expropriation, concession, commercialisation du domaine public : les mots ont un sens
vendredi 25 janvier 2013 à 13:58A mesure que la polémique autour des accords de numérisation de la BnF prend de l’ampleur et rebondit dans la presse générale, on voit apparaître un faisceau de positions révélant des différentes notables d’approches. Si la condamnation de ces partenariats public-privé est large, elle n’est pas non plus unanime. Cette gradation des points de vues est saine et légitime, mais il paraît important de bien cerner la nature exacte de ces nuances pour comprendre ce qu’elles signifient.
Quand on examine attentivement les positions, on se rend compte par exemple que certains s’opposent à ces accords, mais ne considèrent pas que le terme « privatisation » du domaine public soit approprié. D’autres rejoignent l’opposition, mais sans condamner la forme même de ces partenariats, qu’ils rapprochent d’une concession de service public. Certains semblent prêts à admettre une exclusivité sur le domaine public, dans la mesure où elle serait temporaire. D’autres encore estiment ces accords légitimes, justement parce que par nature, on doit pouvoir commercialiser le domaine public.
Il est incontestable également que la BnF et le Ministère de la Culture essaieront de défendre ces projets en jouant sur les mots. Bruno Racine, le président de la BnF a commencé à le faire dans Livres Hebdo, en affirmant qu’il est plus juste de parler «d’exclusivité pour le partenaire qui fournit la prestation, et non de privatisation.»
Il est donc très important de bien cerner ce que signifient les termes expropriation, privatisation, concession, commercialisation, appliqués à la problématique du domaine public, envisagé comme bien commun de la connaissance.
Privatisation du domaine public = expropriation d’un bien commun
C’est Philippe Aigrain sur son blog qui a employé le premier les termes « privatisation » et même « expropriation », à propos de ces accords. Ces qualifications me semblent appropriées pour décrire ce qui est en cours et je les ai reprises à mon compte. Ces mots figurent aussi dans une tribune publiée dans Libération aujourd’hui, signée par Philippe Aigrain, Mélanie Dulong de Rosnay, Daniel Bourrion et moi-même. Elles ont notamment permis de beaucoup mieux cerner le problème par rapport à la dénonciation d’une « commercialisation » du domaine public, employé par certains au début de la mobilisation, qui n’est pas (du tout) approprié. Philippe Aigrain dit ceci :
Ces accords se caractérisent par une privatisation (droits d’exploitation commerciale exclusive pour 10 ans) d’un patrimoine appartenant pour tout (les livres anciens) ou partie (les enregistrements sonores 78 et 33 tours) au domaine public.
[...] voilà la BNF qui privatise le domaine public pour dix ans, et qui se vante que ce soit à son propre profit aussi (donc qu’elle sera durablement intéressée à développer cette privatisation du bien commun) et qu’elle réinvestira les sommes en résultant dans d’autres projets de numérisation (dont il reste à voir s’ils ne conduiront pas à de nouvelles privatisations).
[...] Il serait donc normal sous prétexte que l’Etat est fauché et qu’il y aura des bénéfices d’accessibilité à terme (dix ans sauf pour quelques « bonus » et au fur et à mesure de la numérisation dans les seuls locaux de la BNF) d’exproprier chacun d’entre nous des droits qu’il a à l’égard du domaine public pour en attribuer le privilège d’exploitation exclusive à des acteurs économiques.
Ces propos cernent à mon sens exactement les contours du problème, avec des mots renvoyant à des choses précises : ce qui est inacceptable, ce n’est pas le fait d’avoir conclu un partenariat avec une firme privée ; ce n’est pas non plus que cet accord implique une forme de commercialisation du domaine public ; c’est l’exclusivité accordée à ce partenaire qui porte atteinte au domaine public en tant que bien commun de la connaissance. Cette exclusivité, si on veut en analyser la nature exacte, comporte deux dimensions : une exclusivité commerciale réservant l’exploitation des contenus à un seul acteur et une exclusivité d’accès, qui empêche la mise en ligne et oblige à passer par les bases de données des prestataires pour accéder aux œuvres numérisées.
Il y a bien ici en outre expropriation, car le domaine public présente une nature particulière. Il ne s’agit pas d’un simple bien public, dont l’Etat pourrait disposer comme bon lui semble. Les ouvrages physiques sont certes des biens publics, tout comme le sont les murs des tours de la BnF. Mais les oeuvres incorporées par ces livres ou ces enregistrements, une fois les droits patrimoniaux éteints après la fin des droits d’auteur, ne sont pas des biens publics. L’Etat n’a aucun titre de propriété sur elles : il s’agit véritablement d’un bien commun de l’Humanité, sur lequel nul ne peut revendiquer un titre exclusif de propriété.
Il existe certes un certain flou en jurisprudence sur ce point, le Conseil d’Etat ayant tendance parfois à assimiler le domaine public au sens de la propriété littéraire et artistique à un bien public, sans prendre en compte les oeuvres en elles-même. Mais il n’a pour l’instant jamais été formellement établi que le régime de propriété publique que les institutions peuvent revendiquer sur les ouvrages physiques puisse être étendu aux versions numériques. Et c’est très bien ainsi.
Ces accords ne peuvent s’analyser comme une concession de service public.
Dans le montage des partenariats BnF, un droit exclusif d’exploitation est conféré aux acteurs privés, mais s’agissant du domaine public, il n’existe pas de fondement juridique valable qui permette de justifier une telle restriction. La BnF n’est pas propriétaire des oeuvres du domaine public : elle ne pouvait pas délivrer une telle exclusivité. On est ici typiquement dans la prolongation des pratiques de copyfraud que l’on peut souvent constater au sein des institutions publiques dépositaires du patrimoine culturel. Le régime de propriété publique applicable aux oeuvres physiques ne donne pas de prérogatives sur les « oeuvres immatérielles » au sens de la propriété intellectuelle. Beaucoup des confusions rencontrées dans cette affaire résultent de cette confusion entre le matériel et l’immatériel.
Le principal risque lorsqu’on s’abandonne à ce genre d’amalgames consiste à raisonner sur de fausses analogies, notamment celle de la concession de service public. C’est la base du raisonnement du blogueur Authueil, par ailleurs favorable à ces accords :
Certains hurlent à l’atteinte intolérable au domaine public, parlant même de privatisation. Personnellement, je ne vois pas où est le problème. Les documents sont toujours consultables, dans les conditions actuelles, et à terme, tout sera en ligne gratuitement. Les sociétés privées ont juste le droit, pendant 10 ans, de développer un service qui n’existe pas actuellement. Mais en aucun cas, la propriété de quoi que ce soit du domaine public leur est transféré [...] Il n’y a pas privatisation, il y a concession, et sans restriction des accès existants.
On retrouve cette même assimilation dans la déclaration de l’ADBU (Association des Directeurs de Bibliothèques Universitaires), qui repousse fermement ces accords, mais sans remettre en question la forme même de ces partenariats, au motif qu’on pourrait les assimiler à une concession de service public :
Sur le plan commercial, le partenariat conclu avec Proquest apparaît équilibré : financement public-privé pour une exploitation privée de 10 ans (mais semble-t-il exclusive) puis un accès public. Il s’agit en somme d’une concession de service public, auquel se voit contrainte la BnF qui, après 5 ans de RGPP, continue de subir d’importantes restrictions budgétaires cette année encore.
Le rapprochement est pourtant trompeur, car on ne peut raisonner avec le domaine public et la Connaissance comme on le ferait avec des autoroutes ou des bâtiments publics. Lorsque l’Etat concède à un entrepreneur la construction et la gestion d’une autoroute il possède un droit sous-jacent, sur les terrains où cette voie va être créée. Il achète ou exproprie même au besoin des propriétaires privés pour pouvoir constituer cette propriété publique. Il y a donc bien une propriété publique, qui est le fondement même de la concession. Mais avec le domaine public, sauf à s’appuyer sur divers maquillages juridiques relevant du copyfraud, l’Etat n’a pas ce titre de propriété qui lui serait indispensable pour concéder le service. On ne peut concéder ce dont on n’est pas propriétaire.
Il est faux de dire comme le fait Authueil que « rien de la propriété du domaine public » n’est transféré. L’octroi d’une exclusivité implique nécessairement un titre de propriété sous-jacent. Même si le transfert n’est pas définitif (la propriété n’est de toutes façons jamais définitive en matière littéraire et artistique), l’exclusivité sous-entend nécessairement la revendication d’un droit de propriété qui n’existe pas en l’occurrence C’est pourquoi il serait fondamental d’ailleurs de pouvoir connaître quel fondement invoque la BnF dans les contrats pour justifier cette exclusivité. Je suis prêt à parier que l’équation aura été pour eux insoluble et qu’ils auront accordé cette exclusivité dans invoquer aucun fondement juridique réel, ce qui les exposera au risque d’une annulation en justice.
Voilà aussi pourquoi la réponse de Bruno Racine à Livres Hebdo est particulièrement poussive, lorsqu’il dit qu’il serait plus juste de parler « d’exclusivité pour le partenaire qui fournit la prestation, et non de privatisation ». C’est vraiment ce qu’on appelle se tirer une balle dans le pied…
Il y a bien ici privatisation, justement parce qu’une exclusivité a été concédée à un prestataire sur le domaine public. Entendons-nous bien, il existe des privatisations, dont on peut discuter le bien-fondé (transports, télécommunications), mais qui s’inscrivent dans un cadre légal. Ici, il serait plus juste de dénoncer une privatisation opérée sans base légale et sur un objet, le domaine public, qui par nature ne peut faire l’objet d’une tel traitement. C’est en ce sens qu’il y a expropriation, mais là encore le mot n’est pas exactement le bon. Il y a ici destruction d’un bien commun par un processus d’enclosure, au sens très fort que la théorie des biens communs donne à ce terme, qui implique la mise en oeuvre d’une violence illégitime et une logique de démantèlement.
Pourquoi l’opposition actuelle n’a rien à voir avec un refus de la commercialisation du domaine public, bien au contraire !
La déclaration « Non à la privatisation du domaine public à la BnF ! » que de nombreuses organisations ont signé a été jugée par certains comme marquée politiquement. Il s’agirait en gros d’un texte d’extrême-gauche, qui s’opposerait pour des raisons idéologiques à la privatisation, ou au principe même que l’on puisse faire un usage commercial du domaine public.
C’est un point de vue très clairement exprimé chez le blogueur Christophe Henner, se faisant l’écho de débats visiblement complexes au sein de Wikimedia France pour arrêter une position sur le sujet :
Ce contre quoi la lettre, qui je crois ne doit pas être signée par Wikimédia France, s’élève est spécifiquement l’exclusivité et l’exploitation commerciale des numérisations d’œuvres dans le domaine public.
Depuis que je me bats pour la promotion et le développement de la connaissance libre, et j’ose espérer que ça ne changera pas, je me bats, entre autres, pour que les gens puissent réutiliser les contenus de manière non-commerciale ET commerciale. Je ne reviendrais jamais sur ça.
Une oeuvre dans le domaine public doit pouvoir faire l’objet d’une exploitation commerciale. C’est capital, et je reviendrais sur ce point en fin d’explication.
Sur la forme, je trouve la lettre assez « effrayante » par le champ sémantique utilisé. Quand on parle de « firmes privés » et de « privatisation du domaine public », je suis coi. Je me bats, via Wikimédia France, pour la connaissance libre pas pour une vision politique. Pourtant ces termes sont porteurs d’une vision politique. Je me suis suffisamment débattu pour que Wikimédia France soit apolitque et j’espère bien qu’elle le restera bien longtemps
Il y a une confusion importante dans ce raisonnement, qui résulte du fait que l’auteur met sur le même plan exclusivité et exploitation commerciale. Cela le conduit d’ailleurs à entrer en contradiction avec les valeurs qu’il défend. Il n’a jamais été question dans la déclaration visée de s’opposer au principe même que l’on puisse faire un usage commercial du domaine public. Elle vise justement à ce que de nouvelles couches de restrictions ne soient pas appliquées sur le domaine public pour empêcher la réutilisation, aussi bien commerciale que non-commerciale.
Dans un billet précédent, je rappelais également le point de vue exprimé par Hervé Le Crosnier sur la question, qui soutient cette déclaration :
Hervé Le Crosnier explique très bien dans son interview sur Actualitté que le domaine public a naturellement vocation à être exploité commercialement, sous forme de rééditions, traductions ou adaptations, notamment. Le problème n’est pas la commercialisation, mais la privatisation du domaine public, qui passe dans ces accords par le fait d’avoir octroyé des exclusivités de 10 ans aux partenaires privés.
Ce que ne voit pas Christophe Henner, c’est que l’exclusivité accordée aux prestataires privées dans ces partenariats est précisément une exclusivité commerciale, qui va empêcher des entreprises tierces de faire un usage commercial des contenus. Se battre contre cette exclusivité, c’est justement lutter pour que l’usage commercial reste ouvert, parce que qu’il fait intrinsèquement partie de la définition même du domaine public. On notera d’ailleurs que de nombreuses associations issues de la sphère du Libre ont signé cette déclaration, sans y voir cette charge contre la commercialisation que dénonce Christophe Henner.
Les termes « privatisation » ou « firmes privés » employés n’ont en fait ici pas de dimension politique. Ce n’est pas faire de la politique politicienne que de lutter pour préserver les biens communs de la connaissance (même si c’est un enjeu politique majeur pour le XXIème). Il aurait sans doute été plus juste de dénoncer ici l’enclosure d’un bien commun, plutôt que la privatisation du domaine public, mais ces termes, beaucoup plus exacts, ne sont certainement pas encore assez connus au-delà d’un cercle restreint pour mobiliser dans le cadre d’une telle action. C’est à nous d’ailleurs de faire en sorte qu’ils le deviennent, mais il s’agit d’un travail de fond.
Dans cette affaire d’ailleurs, je dénoncerai d’ailleurs beaucoup plus l’attitude de la personne publique, en l’occurence la BnF et l’Etat, que les firmes privées en cause. Mon engagement sur le thème des biens communs m’a d’ailleurs conduit graduellement à me rendre compte que les acteurs publics peuvent s’avérer tout aussi redoutables pour les biens communs que les acteurs privés. Dans un billet précédent consacré lui aussi à la numérisation et au domaine public, je disais ceci :
Il y a quatre ans, j’étais défavorable à ce partenariat avec Google, parce que je pensais qu’une solution publique pouvait être mise en place en France, qui préserverait le domaine public.
Depuis, j’ai constaté avec horreur que les personnes publiques et l’Etat sont tout aussi menaçants pour le domaine public que ne le sont les grandes firmes privées.
Les bibliothèques protègent le patrimoine, mais qui protège celui-ci des errances de l’action publique ?
Le combat pour les biens publics a d’ailleurs ce mérite de sortir de l’opposition entre privé et public, entre le marché et l’Etat, pour faire entrevoir de nouveaux positionnements.
Les mots sont importants, parce qu’ils nous permettent d’entrevoir une solution au problème.
Cette réflexion sur les mots et les concepts est à mon sens tout à fait essentielle, car elle dessine ce que pourrait être une sortie de cette crise.
Wikimedia France a publié une déclaration dans laquelle elle propose en conclusion des pistes de solution que j’ai bien du mal à partager :
Dans une période de moindre financement, nous pouvons entendre qu’il vaut mieux mettre à disposition les scans de ces ouvrages dans dix ans que ne pas les numériser du tout.
Nous accueillerions donc avec joie un effort de transparence de la part de la BnF afin que soient présentées les pistes suivies afin de démontrer que le partenariat public/privé a été choisi en dernière instance car seule solution réellement implémentable.
Nous pensons également que le partenariat peut être amendé. En particulier, si nous nous réjouissons que les scans soient disponibles dans les murs de la BnF (où se trouvent déjà l’exemplaire originel), il nous semble important que des points d’accès existent dans les autres régions afin de promouvoir le principe d’égalité d’accès des citoyens aux services publics et à la connaissance.
A titre personnel (et j’insiste bien là dessus, c’est mon avis personnel), je ne suis pas disposé à accepter l’exclusivité commerciale et l’enclosure d’accès que sous-tendent ces partenariats, pour les raisons que j’ai évoquées ci-dessus. Une issue, comme celle proposée par Wikimedia France, qui consisterait simplement à étendre l’accès dans quelques bibliothèques en France ne lèverait à mes yeux aucunement le problème majeur dans cette affaire, qui réside dans le fait que l’exclusivité accrédite un droit sous-jacent pour l’Etat sur le domaine public, qui ne peut conduire qu’à l’étiolement et à l’affaissement progressif de sa substance.
L’argument consistant à dire qu’il faut se ranger au réalisme économique et qu’en temps de crise de telles solutions doivent être acceptées ne me paraît pas non plus recevable. Il a d’ailleurs été très bien démonté par l’économiste de la culture, Mathieu Perona :
On le sait et le répète, l’État français refuse assez obstinément de se doter des instruments d’évaluation des politiques publiques. On peut même aller plus loin : à gérer les institutions de manière indépendante, il abdique son rôle de coordinateur de l’action publique. Les accords de la BnF sont un cas d’espèce : ils reposent sur la monétisation auprès d’un client public (les établissements d’enseignement et de recherche) d’un contenu détenu par une institution publique, monétisation qui sert à rembourser une avance réalisée par un prestataire privé.
Il y a là une profonde erreur de gestion publique, puisqu’il ne s’agit pas d’une valorisation des collections de la BnF, mais d’un simple transfert de ressources d’une partie de l’administration publique à une autre. Les taux d’emprunt actuels font en outre que le financement direct de la numérisation par ce biais coûterait moins cher que la marge prise par le prestataire.
On nous dit que les caisses sont vides et que l’Etat n’a plus de crédits à consacrer à la numérisation patrimoniale. Pourtant, on a appris récemment que les magazines de la marque Télé-Z recevaient du Ministère de la Culture 23,5 millions par an de subventions. C’est davantage que ce que la BnF perçoit du Centre National du Livre pour conduire ces programmes de numérisation de masse. C’est un exemple, mais combien doit-il y avoir de niches semblables ? Dans ce sujet comme dans d’autres l’argument de la crise est bien pratique, quand il permet de faire l’économie de véritables arbitrages politiques dans les priorités à défendre !
Si le problème réside bien dans l’exclusivité accordée, la solution pour sortir de cette crise consiste à agir sur ce levier. A vrai dire, ces montages traduisent surtout un problème de perception dans la valeur de la numérisation. Ce n’est pas l’accès en lui-même aux contenus qui fait la valeur, mais les services associés qui permettent le traitement de l’information. Pour prendre une exemple, l’existence de Légifrance n’empêche pas des éditeurs juridiques de construire des bases de données et de les vendre, parce qu’ils offrent une valeur ajoutée sur les contenus. L’accès à la loi et à la jurisprudence (autre composante fondamentale du domaine public) reste bien libre et gratuit, sans empêcher la mise en place d’un écosystème économique (qui pourrait d’ailleurs être encore plus riche si Légifrance passait vraiment en Open Data, mais c’est une autre question).
Il pourrait en être de même en matière de numérisation du patrimoine. Un acteur comme ProQuest par exemple est reconnu pour développer des bases de données de qualité, qui offrent un véritable service aux chercheurs. C’est une erreur à mon sens de croire que ProQuest n’aurait pas vendu sa base si les scans avaient été rendus par ailleurs accessibles par ailleurs dans Gallica. Il existe un marché pour ce type de produits à valeur ajoutée, en France et à l’étranger, tout comme les universités ne renoncent pas à acquérir des bases de données juridique sous prétexte qu’existe un Légifrance !
Par ailleurs, l’accès libre en ligne des fichiers n’empêche de développer des services payants à valeur ajoutée. C’est le cas par exemple de la numérisation à la demande, que la BnF a déjà mis en place avec plusieurs partenaires commerciaux, sans accorder à aucun d’exclusivité.
Cette affaire révèle en définitive surtout un problème dans la conception de la valeur à l’ère du numérique, comme le dit d’ailleurs très bien à nouveau Mathieu Perona :
Est sans doute également entrée en ligne de compte l’opinion répandue dans les milieux culturels français que la gratuité dévalorise l’objet, argument déjà entendu lors du débat sur la gratuité des musées. Faire du payant, c’est dans cette perspective affirmer la valeur du corpus, et tant pis pour ceux qui se retrouvent exclus de l’accès aux contenus.
Ces exclusivités peuvent être levées, l’intégrité du domaine public sera préservée et l’intérêt économique même des parties en cause dans cette affaire n’en souffrirait pas. Mais après une telle alerte, nous ne pourrons faire l’économie d’une réflexion générale en France sur le financement de la numérisation, la préservation du domaine public et les liens à tisser avec les acteurs économiques. Ce serait d’ailleurs le meilleur moyen de transformer cette crise en quelque chose de positif.
Classé dans:Domaine public, patrimoine commun Tagged: Biens Communs, concession, Domaine public, Numérisation, privatisation
![]()